La France Galante
From The Art and Popular Culture Encyclopedia
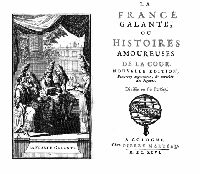
|
Related e |
|
Featured: |
La France Galante (1696) is a book published by the fictional publishing house Pierre Marteau attributed by Robert Darnton in The Devil in the Holy Water (2009) to Gatien de Courtilz de Sandras.
Full text
LA
FRANCE GALANTE
OU
HISTOIRES AMOUREUSES
DE LA COUR.
(Mme DE MONTESPAN, Mlle DE MONTPENSIER, etc.)
Jamais cour ne fut si galante que celle du grand Alcandre [1]. Comme il étoit d’une complexion amoureuse, chacun, qui se fait un plaisir de suivre l’exemple de son prince, fit ce qu’il put pour se mettre bien auprès des dames. Mais celles-ci leur en épargnèrent la peine bientôt. Soit qu’elles se plussent à faire des avances, ou qu’elles eussent peur de n’être pas du nombre des élues, l’on remarqua que sans attendre ce que la bienséance leur ordonne, elles se mirent dans peu de temps à courir après les hommes. Cela fut cause qu’il y en eut beaucoup qui les méprisèrent, d’où se seroit ensuivie la reconnoissance de leur faute, si ce n’est que le tempérament l’emporta sur la réflexion.
Madame de Montespan [2] fut de celles-là. Elle passoit pour une des plus belles personnes du monde. Cependant elle avoit encore plus d’agrément dans l’esprit que dans le visage [3]. Mais toutes ces belles qualités étoient effacées par les défauts de l’âme, qui étoit accoutumée aux plus insignes fourberies, tellement que le vice ne lui coûtoit plus rien. Elle étoit d’une des plus anciennes maisons du royaume, et son alliance autant que sa beauté avoit été causé que M. de Montespan l’avoit recherchée en mariage, et l’avoit préférée à quantité d’autres qui auroient beaucoup mieux accommodé ses affaires.
Madame de Montespan, qui n’avoit souhaité d’être mariée que pour pouvoir prendre l’essor, ne fut pas plus tôt à la cour qu’elle fit de grands desseins sur le cœur du grand Alcandre. Mais comme il étoit pris en ce temps-là, et que madame de La Vallière, personne d’une médiocre beauté, mais qui avoit mille autres bonnes qualités en récompense, le possédoit entièrement, elle fit bien des avances inutiles et fut obligée de chercher parti ailleurs.
Comme elle méprisoit tout ce qui n’approchoit pas de la couronne [4], elle jeta les yeux sur Monsieur, frère du grand Alcandre, qui lui témoigna de la bonne volonté, plutôt pour faire croire qu’il pouvoit être amoureux des dames que pour ressentir aucune chose pour elle qui approchât de l’amour [5]. Monsieur surprit par là un grand nombre de personnes, qui ne le croyoient pas sensible pour le beau sexe ; mais le chevalier de Lorraine, jaloux de ce nouvel attachement, fit revenir bientôt le prince à ses premières inclinations ; et comme il avoit son étoile, madame de Montespan n’eut que des apparences, pendant qu’il eut toute la part dans ses bonnes grâces.
Madame de Montespan, qui ne s’étoit retranchée au cœur de Monsieur que pour n’avoir pu réussir sur celui du Roi, en fut encore plus dégoûtée quand elle vit qu’il le falloit partager avec le chevalier de Lorraine, qui n’avoit rien de recommandable que la naissance ; elle résolut de mépriser qui la méprisoit, et fit de grands reproches à Monsieur, qui s’en consola avec le chevalier de Lorraine.
La beauté de madame de Montespan étoit cependant le sujet des désirs de toute la cour, et particulièrement de M. de Lauzun [6], favori du grand Alcandre, homme d’une taille peu avantageuse et d’une mine fort médiocre, mais qui récompensoit ces deux défauts par deux grandes qualités, c’est-à-dire par beaucoup d’esprit et par un je ne sais quoi qui faisoit que quand une dame le connoissoit une fois elle ne le quittoit pas volontiers pour un autre. D’ailleurs la faveur où il étoit auprès du Roi le rendoit recommandable ; si bien que madame de Montespan, qui avoit ouï parler de ses belles qualités, et qui vouloit savoir par expérience si on ne lui en donnoit point plus qu’il n’en avoit effectivement, ne dédaigna pas les offres de service qu’il lui fit. Cependant, comme il y avoit beaucoup de politique mêlée avec sa curiosité, elle le fit languir pendant cinq ou six semaines sans lui vouloir accorder la dernière faveur ; et pendant qu’elle le faisoit attendre, il arriva une affaire à ce favori qui le devoit perdre auprès de son maître, s’il n’eût été plus heureux que sage.
Le grand Alcandre, tout élevé qu’il étoit par dessus les autres hommes, n’étoit pas d’une autre humeur ni d’un autre tempérament que les hommes du commun. Quoiqu’il aimât passionnément madame de La Vallière, il se sentoit épris quelquefois de la beauté de quelques dames et étoit bien aise de satisfaire son envie. Il étoit dans ces sentimens pour la princesse de Monaco [7], dont M. de Lauzun possédoit les bonnes grâces ; et comme M. de Lauzun se croyoit capable, à cause de ses grandes qualités que j’ai remarquées ci-devant, de conserver l’amitié de la princesse de Monaco et de se mettre bien dans le cœur de madame de Montespan, il défendit à la princesse de Monaco, qui lui avoit découvert la passion du grand Alcandre, d’y répondre aucunement [8], et la menaça, s’il s’apercevoit du contraire, de la perdre de réputation dans le monde.
Ces menaces, au lieu de plaire à la princesse de Monaco, lui firent penser à sortir de la tyrannie qu’il vouloit exercer sur elle ; et, prenant en même temps des mesures avec le grand Alcandre, ce qu’elle n’avoit point fait auparavant, elle le fit résoudre d’envoyer M. de Lauzun à la guerre, où il avoit une grande charge [9]. Ainsi le grand Alcandre ayant dit à M. de Lauzun qu’il se tînt prêt à partir dans deux ou trois jours, M. de Lauzun demeura tout surpris à cette nouvelle ; et en devinant la cause aussitôt, il dit au grand Alcandre qu’il n’iroit point à l’armée, à moins qu’il ne lui en donnât le commandement ; qu’il voyoit bien cependant pourquoi il vouloit l’y envoyer ; que c’étoit pour jouir paisiblement de sa maîtresse pendant son absence ; mais qu’il ne seroit pas dit qu’on le trompât si grossièrement, sans qu’il fît voir du moins qu’il s’apercevoit qu’on le trompoit ; que cette action étoit d’un perfide plutôt que d’un grand prince, tel qu’il l’avoit toujours estimé ; mais qu’il étoit bien aise de le connoître, afin de ne s’y pas tromper dorénavant.
Quoique le grand Alcandre eût toujours accoutumé de parler en maître, et que personne n’eût osé jusque-là lui faire aucun reproche, il ne laissa pas d’écouter M. de Lauzun jusqu’au bout. Mais voyant que sa folie continuoit toujours de plus en plus, il lui demanda froidement s’il extravaguoit, et s’il se souvenoit bien qu’il parloit à son maître, et à celui qui pouvoit l’abaisser en aussi peu de temps qu’il l’avoit élevé. M. de Lauzun lui répondit qu’il savoit tout cela aussi bien que lui ; qu’il savoit bien encore que c’étoit à lui seul à qui il étoit redevable de sa fortune, n’ayant jamais fait sa cour à aucun ministre, comme tous les autres grands du royaume ; mais que tout cela ne l’empêchoit pas de lui dire ses vérités. Et, continuant sur le même ton, il alloit dire encore quantité de choses ridicules et extravagantes, quand le grand Alcandre le prévint, lui disant qu’il ne lui donnoit que vingt-quatre heures pour se résoudre à partir, et que, s’il ne lui obéissoit, il verroit ce qu’il auroit à faire.
L’ayant quitté après ce peu de paroles, M. de Lauzun entra en un désespoir inconcevable, et comme il attribuoit tout ce qui venoit d’arriver à l’intelligence que la princesse de Monaco commençoit d’avoir avec lui, il s’en fut chez elle, et, ne l’ayant point trouvée, il cassa un grand miroir, comme s’il eût été bien vengé par là. La princesse de Monaco s’en plaignit au grand Alcandre, qui lui répondit que c’étoit un fou dont elle alloit être assez vengée par son absence ; qu’il en avoit souffert lui-même des choses surprenantes, mais qu’il lui pardonnoit tout cela, considérant bien qu’il devoit être au désespoir de perdre les bonnes grâces d’une dame qui avoit autant de mérite qu’elle en avoit.
Au bout des vingt-quatre heures, il demanda à M. de Lauzun à quoi il étoit résolu : à quoi ayant répondu que c’étoit à ne point partir s’il ne lui donnoit le commandement de l’armée, le grand Alcandre se mit en colère contre lui, et le menaça tout de nouveau de le réduire en tel état qu’il auroit lieu de se repentir de l’avoir poussé à bout. Mais M. de Lauzun, n’en devenant pas plus sage pour toutes ces menaces, lui répondit que tout le mal qu’il lui pouvoit faire étoit de lui ôter la charge de général des dragons qu’il lui avoit donnée, et que, comme il l’avoit bien prévu, il en avoit la démission dans sa poche. Il la tira en même temps et la lui jeta sur une table auprès de laquelle il étoit assis ; ce qui fâcha tellement le grand Alcandre, qu’il l’envoya à l’heure même à la Bastille. On fut étonné de sa disgrâce, personne ne sachant encore ce qui étoit arrivé, et devinant encore moins jusqu’où avoit été la brutalité de ce favori.
Madame de Montespan, ayant appris son malheur, fut ravie du retardement qu’elle avoit apporté à son intrigue, et ne se mit pas beaucoup en peine de le consoler, croyant qu’après sa folie, dont on commençoit à parler dans le monde, il n’y auroit plus de retour pour lui aux bonnes grâces du grand Alcandre. Cependant sa disgrâce ne dura pas si longtemps qu’on s’étoit imaginé, car le grand Alcandre, n’ayant pas trouvé dans la possession de la princesse de Monaco assez de charmes pour le retenir, n’eut pas plutôt passé sa fantaisie qu’il pardonna à M. de Lauzun, qui revint à la cour avec plus de crédit que jamais ; dont néanmoins chacun demeura assez étonné, ne croyant pas que, de l’humeur dont étoit le grand Alcandre, il dût jamais oublier le manque de respect qu’il avoit eu pour lui.
Le retour de M. de Lauzun à la cour ayant fait concevoir à tout le monde qu’il falloit qu’il eût un grand ascendant sur l’esprit du grand Alcandre, chacun s’empressa de lui donner des marques de son attachement. Madame de Montespan, entr’autres, ne lui put refuser ses dernières faveurs. Cette nouvelle intrigue, qui devoit consoler M. de Lauzun de l’infidélité de la princesse de Monaco, n’empêcha pas qu’il ne songeât à s’en venger. Il en trouva l’occasion quelques jours après. Cette dame étoit assise avec plusieurs autres sur un lit de gazon, et ayant la main sur l’herbe : il mit son talon dessus, comme par mégarde ; puis ayant fait une pirouette pour appuyer davantage, il se tourna vers elle, faisant semblant de lui demander pardon.
La douleur que la princesse de Monaco sentit lui fit faire un grand cri ; mais, y étant encore moins sensible qu’à un rire moqueur que M. de Lauzun affectoit en s’excusant, elle lui dit mille injures, et fit comprendre à tous ceux qui étoient là qu’on ne pouvoit tant s’emporter contre un homme sans en avoir d’autres raisons. M. de Lauzun, qui avoit intérêt de conserver sa réputation parmi les dames, laissa évaporer son ressentiment en reproches, sans y vouloir répondre que par des soumissions et des excuses ; et les dames qui étoient là s’étant mêlées de les accommoder, la princesse de Monaco fut obligée de s’apaiser, pour ne leur pas donner à connoître clairement que son chagrin procédoit d’ailleurs [10].
La princesse de Monaco ayant ainsi perdu son amant et n’ayant fait que tâter, s’il faut ainsi dire, du grand Alcandre, elle chercha à s’en consoler par la conquête de quelque autre. Mais, comme son tempérament ne la rendoit pas cruelle, et que son appétit ne lui permettoit pas d’ailleurs de se contenter d’un seul, elle tenta tant de hasards qu’elle y succomba à la fin. Un page beau et bien fait, mais qui couroit tout Paris, à la manière des pages, lui ayant plu, elle voulut voir si elle s’en trouveroit mieux que de quantité de gens de qualité dont elle avoit essayé jusque-là. Mais celui-ci s’étant trouvé malade, il lui communiqua sa maladie, dont ne se faisant pas traiter assez promptement, peut-être pour ne pas savoir d’abord ce que c’étoit, peut-être aussi par la peine qu’elle avoit à se découvrir, elle mourut dans les remèdes [11], faisant voir par sa mort quelle appréhension doivent avoir celles qui l’imitent dans ses débauches.
Les parens de la princesse de Monaco cachèrent avec grand soin la nature de sa maladie ; mais Monsieur, frère du grand Alcandre, qui avoit eu quelque commerce avec elle, quoique de peu de durée, et qui, pour récompense de ses services et pour ceux qu’elle avoit rendus au chevalier de Lorraine, lui avoit donné la charge de surintendante de la maison de sa femme, eut peur d’être enveloppé dans son malheur. Ainsi il n’eut point de repos jusqu’à ce qu’il eût assemblé quatre personnes des plus habiles dans ce genre de maladie, pour savoir s’il n’y avoit rien à craindre pour lui. Ils l’assurèrent que non, ce qui remit son esprit entièrement et lui fit oublier cette personne, dont il avoit peur de se souvenir malgré lui.
Le grand Alcandre soupçonna l’intrigue de madame de Montespan et de M. de Lauzun, et, comme l’amour entre de plusieurs manières dans le cœur des hommes, la réflexion qu’il fit sur le bonheur de son favori lui fit considérer de plus près qu’il n’avoit fait jusque-là le mérite et la beauté de cette dame. D’ailleurs la possession de madame de La Vallière commençoit à lui donner du dégoût, malheur inséparable des longues possessions. Comme madame de Montespan avoit une attention toute particulière sur la personne du grand Alcandre, elle s’aperçut bientôt à ses regards et à ses actions qu’il n’étoit pas insensible pour elle ; et, comme elle savoit que pour fomenter des sentimens amoureux, la présence est la chose du monde la plus nécessaire, elle fit tout son possible pour s’établir à la cour : ce qu’elle crut pouvoir faire si elle entroit une fois dans la confidence de madame de La Vallière, qui cherchoit de son côté à se décharger sur quelque bonne amie du déplaisir qu’elle avoit de la tiédeur des feux du grand Alcandre. Les avances que madame de Montespan faisoit à madame de La Vallière lui ayant plu, il se lia une espèce d’amitié entre ces deux dames, ou du moins quelque apparence d’amitié ; car je sais bien que madame de Montespan, qui avoit son but, n’avoit garde d’aimer madame de La Vallière, elle qui étoit l’unique obstacle à ses desseins. Le grand Alcandre, qui se sentoit déjà quelque chose de tendre pour elle, fut ravi de la voir tous les jours avec madame de La Vallière, qui en étoit charmée pareillement, parce qu’elle entroit adroitement dans tous ses intérêts et avoit une complaisance toute particulière pour elle. De fait, elle blâmoit non-seulement le grand Alcandre de son indifférence, mais lui fournissoit encore des moyens pour le faire revenir, sachant bien que quand deux amans commencent à se dégoûter l’un de l’autre, il est comme impossible de les rapatrier.
Cependant le grand Alcandre, pour avoir le plaisir de voir madame de Montespan, alloit plus souvent chez madame de La Vallière qu’il n’avoit de coutume, et madame de La Vallière, se faisant l’application de ces nouvelles assiduités, en aimoit encore davantage madame de Montespan, croyant que c’étoit par ses soins qu’elle jouissoit plus souvent de sa vue. Mais enfin, comme elle avoit eu part dans les véritables affections de son cœur, elle s’aperçut bientôt qu’il y avoit du déguisemen dans tout ce qu’il lui disoit, et la passion qu’elle avoit pour lui lui tenant lieu d’esprit, dont elle n’étoit pas trop bien partagée de sa nature [12], elle conçut que madame de Montespan la jouoit, et que le grand Alcandre étoit mieux avec elle qu’elle n’avoit cru jusque-là.
D’abord que ce soupçon se fut emparé de son esprit, elle les observa de si près, qu’elle ne fit plus de doute qu’on la trompoit. Et sa passion ne lui permettant pas de garder plus longtemps le secret, elle s’en plaignit tendrement au grand Alcandre, qui lui dit qu’il étoit de trop bonne foi pour l’abuser davantage ; qu’il étoit vrai qu’il aimoit madame de Montespan, mais que cela n’empêchoit pas qu’il ne l’aimât comme il devoit ; qu’elle se devoit contenter de tout ce qu’il faisoit pour elle, sans désirer rien davantage, parce qu’il n’aimoit pas à être contraint.
Cette réponse, qui étoit d’un maître plutôt que d’un amant, n’eut garde de satisfaire une maîtresse aussi délicate qu’étoit madame de La Vallière : elle pleura, elle se plaignit ; mais le grand Alcandre n’en étant pas plus attendri pour tout cela, il lui dit pour une seconde fois que, si elle vouloit qu’il continuât de l’aimer, elle ne devoit rien exiger de lui au delà de sa volonté ; qu’il désiroit qu’elle vécût avec madame de Montespan comme par le passé, et que, si elle témoignoit la moindre chose de désobligeant à cette dame, elle l’obligeroit à prendre d’autres mesures.
La volonté du grand Alcandre servit de loi à madame de La Vallière. Elle vécut avec madame de Montespan dans une concorde qu’on ne devoit point vraisemblablement attendre d’une rivale [13], et elle surprit tout le monde par sa conduite, parce que tout le monde commençoit à être persuadé que le grand Alcandre se retiroit d’elle peu à peu et se donnoit entièrement à madame de Montespan.
Cependant, comme le grand Alcandre étoit un amant délicat et qu’il ne pouvoit souffrir qu’un mari partageât avec lui les faveurs de sa maîtresse, il résolut de l’éloigner sous prétexte de lui donner de grands emplois ; mais ce mari ayant l’esprit peu complaisant, il refusa tout ce qu’on lui offrit, se doutant bien que le mérite de sa femme contribuoit plus à son élévation que tout ce qu’il pouvoit y avoir de recommandable en lui.
Madame de Montespan, qui avoit pris goût aux caresses du grand Alcandre, ne pouvant plus souffrir celles de son mari, ne lui voulut plus rien accorder, ce qui mit M. de Montespan dans un tel désespoir que, quoiqu’il l’aimât tendrement, il ne laissa pas de lui donner un soufflet. Madame de Montespan, qui se sentoit alors de l’appui, le maltraita extrêmement de paroles ; et s’étant plainte de son procédé au grand Alcandre, il exila M. de Montespan, qui s’en alla avec ses enfans [14] dans son pays, proche les Pyrénées. Il prit là le grand deuil, comme si véritablement il eût perdu sa femme, et, comme il y avoit beaucoup de dettes dans sa maison, le grand Alcandre lui envoya deux cent mille francs pour le consoler de la perte qu’il avoit faite.
Cependant, quelque temps après que M. de Montespan fut parti, madame sa femme devint grosse ; et, quoiqu’elle s’imaginât bien que tout le monde savoit ce qui se passoit entre le grand Alcandre et elle, cela n’empêcha pas qu’elle n’eût de la confusion qu’on la vît en l’état où elle étoit. Cela fut cause qu’elle inventa une nouvelle mode, qui étoit fort avantageuse pour les femmes qui vouloient cacher leur grossesse, qui fut de s’habiller comme les hommes, à la réserve d’une jupe, sur laquelle, à l’endroit de la ceinture, on tiroit la chemise, que l’on faisoit bouffer le plus qu’on pouvoit et qui cachoit ainsi le ventre.
Cela n’empêcha pourtant pas que toute la cour ne vît bien ce qui en étoit ; mais comme il s’en falloit peu que les courtisans n’adorassent ce prince, leur encens passa jusqu’à sa maîtresse, chacun commençant à rechercher ses bonnes grâces. Comme elle avoit infiniment de l’esprit, elle se fit des amis autant qu’elle put, ce que n’avoit pas fait madame de La Vallière, qui, pour montrer au grand Alcandre qu’elle n’aimoit que lui, n’avoit jamais voulu rien demander pour personne. Ainsi on ne se fut pas plus tôt aperçu du crédit de sa rivale, que chacun prit plaisir à s’en éloigner. De quoi s’étant plainte au maréchal de Grammont [15], il lui répondit que, pendant qu’elle avoit sujet de rire, elle devoit avoir eu soin de faire rire les autres avec elle, si, pendant qu’elle avoit sujet de pleurer, elle vouloit que les autres pleurassent aussi.
Madame de La Vallière, se voyant ainsi abandonnée de tout le monde, résolut de se jeter dans un couvent ; et, ayant choisi celui des Carmélites, elle s’y retira et y prit l’habit quelque temps après, où elle vit, dit-on, en grande sainteté, ce que je n’ai pas de peine à croire, parce qu’ayant éprouvé, comme elle a fait, l’inconstance des choses du monde, elle voit bien qu’il n’y a qu’en Dieu seul qu’on doive mettre son espérance.
Sa retraite satisfit également le grand Alcandre et madame de Montespan : celle-ci, parce qu’elle appréhendoit toujours qu’elle ne rentrât dans les bonnes grâces du grand Alcandre, dont elle avoit possédé les plus tendres affections ; celui-là, parce que sa présence lui reprochoit toujours son inconstance. Cependant le temps des couches de cette dame approchant, le grand Alcandre se retira à Paris, où il n’alloit que rarement, espérant qu’elle y pourroit accoucher plus secrètement que s’il demeuroit à Saint-Germain, où il avoit coutume de demeurer.
Le terme venu, une femme de chambre de madame de Montespan, en qui le grand Alcandre et elle se confioient particulièrement, monta en carrosse et fut dans la rue Saint-Antoine, chez le nommé Clément, fameux accoucheur de femmes, à qui elle demanda s’il vouloit venir avec elle pour en accoucher une qui étoit en travail. Elle lui dit en même temps que, s’il vouloit venir, il falloit qu’on lui bandât les yeux, parce qu’on ne désiroit cas qu’il sût où il alloit. Clément, à qui de pareilles choses arrivoient souvent, voyant que celle qui le venoit quérir avoit l’air honnête, et que cette aventure ne lui présageoit rien que de bon, dit à cette femme qu’il étoit prêt de faire tout ce qu’elle voudroit ; et, s’étant laissé bander les yeux, il monta en carrosse avec elle, d’où étant descendu après avoir fait plusieurs tours dans Paris, on le conduisit dans un appartement superbe, où on lui ôta son bandeau.
On ne lui donna pas cependant le temps de considérer le lieu ; et devant que de lui laisser voir clair, une fille qui étoit dans la chambre éteignit les bougies ; après quoi le grand Alcandre, qui s’étoit caché sous le rideau du lit, lui dit de se rassurer et de ne rien craindre. Clément lui répondit qu’il ne craignoit rien ; et, s’étant approché, il tâta la malade, et voyant que l’enfant n’étoit pas encore prêt à venir, il demanda au grand Alcandre, qui étoit auprès de lui, si le lieu où ils étoient étoit la maison de Dieu, où il n’étoit permis ni de boire ni de manger ; que pour lui, il avoit grand faim et qu’on lui feroit plaisir de lui donner quelque chose.
Le grand Alcandre, sans attendre qu’une des deux femmes qui étoient dans la chambre s’entremît de le servir, s’en fut en même temps lui-même à une armoire, où il prit un pot de confitures qu’il lui apporta ; et, lui étant allé chercher du pain d’un autre côté, il le lui donna de même, lui disant de n’épargner ni l’un ni l’autre, et qu’il y en avoit encore au logis. Après que Clément eut mangé, il demanda si on ne lui donneroit point à boire. Le grand Alcandre fut quérir lui-même une bouteille de vin dans l’armoire avec un verre, et lui en versa deux ou trois coups l’un après l’autre. Comme Clément eut bu le premier coup, il demanda au grand Alcandre s’il ne boiroit point bien aussi ; et le grand Alcandre lui ayant répondu que non, il lui dit que la malade n’en accoucheroit pourtant pas si bien, et que, s’il avoit envie qu’elle fût délivrée promptement, il falloit qu’il bût à sa santé.
Le grand Alcandre ne jugea pas à propos de répliquer à ce discours, et, ayant pris dans ce temps-là une douleur à madame de Montespan, cela rompit la conversation. Cependant elle tenoit les mains du grand Alcandre, qui l’exhortoit à prendre courage, et il demandoit à chaque moment à Clément si l’affaire ne seroit pas bientôt faite. Le travail fut assez rude, quoiqu’il ne fût pas bien long, et, madame de Montespan étant accouchée d’un garçon [16], le grand Alcandre en témoigna beaucoup de joie ; mais il ne voulut pas qu’on le dît sitôt à madame de Montespan, de peur que cela ne fût nuisible à sa santé.
Clément ayant fait tout ce qui étoit de son métier, le grand Alcandre lui versa lui-même à boire ; après quoi il se remit sous le rideau du lit, parce qu’il falloit allumer de la bougie, afin que Clément vît si tout alloit bien avant que de s’en aller. Clément ayant assuré que l’accouchée n’avoit rien à craindre, celle qui l’étoit allé quérir lui donna une bourse où il y avoit cent louis d’or. Elle lui rebanda les yeux après cela ; puis, l’ayant fait remonter en carrosse, on le remena chez lui avec les mêmes cérémonies : je veux dire qu’on lui banda les yeux, comme on avoit fait en l’amenant.
Cependant M. de Lauzun tâchoit de se consoler dans les bras d’une autre ; et, tout glorieux de ce que le grand Alcandre n’avoit que son reste, il n’envioit aucunement son bonheur, soit qu’il n’eût jamais eu de véritable passion pour madame de Montespan, soit qu’il eût reconnu en elle des défauts cachés que son mari publioit être fort grands, mais sur quoi on ne l’en croyoit pas, parce qu’on savoit qu’il avoit intérêt à en dégoûter. Quoi qu’il en soit, Lauzun, n’étant plus son amant, vécut avec elle en bon ami, du moins selon toutes les apparences ; mais, pour elle, elle ne le pouvoit souffrir, parce que, lui ayant donné de si grandes prises, elle avoit peur qu’il ne la perdît auprès du grand Alcandre, où il n’avoit pas moins de pouvoir qu’elle.
Cependant, comme on n’aime jamais guère ceux qu’on appréhende, elle eût bien voulu en être défaite ; mais elle n’osoit encore l’entreprendre, de peur de n’être pas assez puissante pour en venir à bout. Comme elle étoit dans ces sentimens, la charge de dame d’honneur de la femme du grand Alcandre vint à vaquer par la mort de la duchesse de Montausier [17], et, les duchesses de Richelieu et de Créqui y prétendant toutes deux, chacune employa ses amis pour l’avoir. Madame de Montespan se déclara pour la duchesse de Richelieu [18], et M. de Lauzun pour la duchesse de Créqui [19], ce qui commença à jeter ouvertement de la division entre eux : car M. de Lauzun vouloit à toute force que madame de Montespan se désistât de parler en faveur de la duchesse de Richelieu, et madame de Montespan, ne pouvant pas s’en désister honnêtement après avoir fait les premiers pas, trouva étrange que M. de Lauzun, après avoir su qu’elle avoit entrepris cette affaire, fût venu à la traverse prendre les intérêts de la duchesse de Créqui. C’étoit au grand Alcandre à décider ou en faveur de son favori, ou en faveur de sa maîtresse ; mais ce prince, ne voulant mécontenter ni l’un ni l’autre, demeura longtemps sans donner cette charge, espérant qu’ils s’accorderoient ensemble, et que leur réunion lui donneroit lieu de se déterminer. Mais sa longueur, au contraire, leur faisant croire à l’un et à l’autre que le grand Alcandre n’avoit point d’égard à leurs prières, ils s’en voulurent encore plus de mal qu’auparavant, et même M. de Lauzun commença à tenir des discours si désavantageux de madame de Montespan, qu’elle ne les put apprendre sans désirer d’en tirer vengeance.
Madame de Montespan s’en plaignit au grand Alcandre, qui en fit une sévère réprimande à M. de Lauzun. Mais celui-ci, d’autant plus animé contre elle qu’il voyoit que son crédit l’emportoit par dessus le sien (car le grand Alcandre venoit de donner la charge de la duchesse de Montausier à la duchesse de Richelieu), ne laissa pas de se déchaîner contre elle, et en fit des médisances en plusieurs rencontres. Le grand Alcandre, l’ayant su par une autre que par madame de Montespan, en reprit encore aigrement M. de Lauzun, qui, voyant que le grand Alcandre n’entendoit point raillerie là-dessus, lui promit d’être sage à l’avenir ; et, pour lui faire voir que son dessein étoit de bien vivre dorénavant avec madame de Montespan, il le pria de les remettre bien ensemble, ce que le grand Alcandre lui promit.
En effet, ayant disposé l’esprit de madame de Montespan à lui pardonner, il les fit embrasser le lendemain en sa présence, obligeant M. de Lauzun de lui demander pardon et de lui promettre qu’il n’y retourneroit plus.
Cet accommodement fait, M. de Lauzun fut plus puissant que jamais sur l’esprit du grand Alcandre ; et, comme ce favori avoit une ambition démesurée, que rien ne pouvoit remplir, il se laissa aller à la pensée d’épouser mademoiselle de Montpensier, cousine germaine du grand Alcandre, dans laquelle il y avoit déjà longtemps que sa sœur [20], confidente de la princesse, l’entretenoit. Cette princesse étoit déjà dans un âge assez avancé ; mais, comme elle étoit extraordinairement riche, et que M. de Lauzun estimoit plus cette qualité et le sang dont elle sortoit que tous les agrémens du corps et de l’esprit, il pria sa sœur de lui continuer ses soins ; et, dans la vue de parvenir à un si grand mariage, il fit mille avances à madame de Montespan, ne doutant pas qu’il n’eût grand besoin de son crédit en cette rencontre.
Car, quoique celui qu’il avoit sur l’esprit de ce prince lui fît présumer beaucoup de choses en sa faveur, comme ce qu’il entreprenoit néanmoins étoit de grande conséquence, il avoit peur qu’il n’y donnât pas les mains si facilement. Ainsi, il songea à le gagner par quelque endroit où il eût intérêt lui-même, ce qu’il fit de cette manière : il dépêcha un gentilhomme en qui il avoit beaucoup de confiance vers le duc de Lorraine, qui étoit dépouillé de ses États, pour lui offrir cinq cent mille livres de rente en fonds de terre pour lui et pour ses héritiers, s’il vouloit lui céder ses droits [21]. Le duc de Lorraine, qui ne voyoit pas grande apparence de pouvoir jamais rentrer dans son bien, goûta cette proposition, d’autant plus que c’étoit un homme à tout faire pour de l’argent, ce qui l’avoit mis en l’état où il étoit. Ainsi, Lauzun, se voyant en état de réussir, en témoigna quelque chose au grand Alcandre, à qui il insinua qu’il lui seroit beaucoup avantageux que le duc de Lorraine cédât ses prétentions à quelqu’un qui lui rendît foi et hommage de la duché de Lorraine.
Le grand Alcandre ayant approuvé la chose, M. de Lauzun lui découvrit que, dans la pensée qu’il avoit eue de lui rendre ce service, il avoit écouté quelques propositions de mariage qui lui avoient été faites de la part de mademoiselle de Montpensier, par l’entremise de sa sœur ; qu’il lui demandoit pardon s’il ne l’en avoit pas averti plus tôt, mais qu’il avoit cru ne le pouvoir faire qu’il n’eût tâché auparavant de mettre les choses en état de réussir ; que c’étoit à lui à approuver ce mariage, qui, tout extraordinaire qu’il paroissoit, n’étoit pas néanmoins sans exemple ; que ce ne seroit pas là la première fois que des mortels se seroient alliés au sang des Dieux, et que l’histoire lui apprenoit que beaucoup de personnes qui n’étoient pas de meilleure maison que lui étoient arrivées à cet honneur.
Le grand Alcandre fut surpris de cette proposition, qui lui parut bien hardie pour un homme de la volée de M. de Lauzun. Cependant, faisant réflexion sur ce que ce n’étoit pas là la première fois qu’une princesse du sang royal auroit épousé un simple gentilhomme, et sur les avantages qu’il pouvoit retirer lui-même de cette alliance, il s’accoutuma bientôt à en entendre parler. Madame de Montespan, que M. de Lauzun avoit engagée dans ses intérêts, trouvant le grand Alcandre déjà bien ébranlé, sut lui représenter si adroitement qu’il n’y avoit point de différence en France entre les gentilshommes, quand ils étoient une fois ducs et pairs (ce qui lui étoit aisé de faire en faveur de M. de Lauzun) et les princes étrangers, à l’un desquels il avoit donné il n’y avoit pas longtemps une sœur de mademoiselle de Montpensier [22], qu’elle acheva de le résoudre.
Quand le grand Alcandre eut ainsi donné son consentement à madame de Montespan, il prit des mesures avec elle et avec M. de Lauzun afin de se disculper dans le monde du consentement qu’il donnoit à ce mariage. Cependant il ne crut rien de plus propre à cela que de paroître y avoir été forcé. Pour cet effet, il voulut deux choses : l’une, que mademoiselle de Montpensier vînt elle-même le prier de lui donner M. de Lauzun en mariage ; l’autre, que les plus considérables d’entre les parens de M. de Lauzun vinssent en corps lui demander la permission que leur parent épousât cette princesse [23]. On vit donc arriver ces ambassadeurs et cette ambassadrice tous en même temps ; et, ceux-là ayant eu audience les premiers, ils dirent au grand Alcandre que, quoique la grâce qu’ils avoient à lui demander en faveur de leur parent semblât être au-dessus de leur mérite et même au-dessus de leurs espérances, ils le prioient néanmoins de considérer que ce seroit le moyen de porter la noblesse aux plus grandes choses, chacun espérant dorénavant de pouvoir parvenir à un si grand honneur pour récompense de ses services.
Ils représentèrent encore au grand Alcandre ce que j’ai touché ci-devant, savoir, qu’il y avoit beaucoup d’autres gentilshommes à qui l’on avoit accordé la même grâce, tellement que, le grand Alcandre paroissant se laisser aller à leurs prières, il leur répondit qu’il vouloit bien, à leur considération, comme étant de la première noblesse de son royaume, que leur parent eût l’honneur d’épouser mademoiselle de Montpensier, mais qu’il vouloit cependant savoir d’elle-même si elle se portoit volontiers à cette alliance, ce qu’il ne savoit pas encore tout à fait.
On fit donc entrer en même temps cette princesse, qui, sans considérer que ce n’étoit guère la coutume que les femmes demandassent les hommes en mariage, pria le grand Alcandre de lui permettre d’épouser M. de Lauzun. À quoi le grand Alcandre s’étant opposé d’abord, mais d’une manière à lui faire voir seulement qu’il vouloit sauver les apparences, la princesse réitéra ses prières, et obtint enfin ce qu’elle demandoit.
La nouvelle de ce mariage fit grand bruit, non-seulement dans tout le royaume, mais encore beaucoup plus loin, chacun ne se pouvant lasser d’admirer les effets de la fortune qui favorisoit tellement un homme qui en paroissoit si indigne, qu’ôté ses vertus cachées, il y en avoit cent mille dans le royaume qui valoient beaucoup mieux que lui.
Cependant, quoiqu’il eût beaucoup d’esprit, il fit une grande faute en cette rencontre ; car, au lieu d’épouser mademoiselle de Montpensier au même temps, il s’amusa à faire de grands préparatifs pour ses noces ; et, cela les retardant de quelques jours, le prince de Condé et son fils furent se jeter aux pieds du grand Alcandre, pour le prier de ne pas permettre qu’une chose si honteuse à toute la maison royale s’achevât. Le grand Alcandre fut fort ébranlé à ces remontrances, et, comme il ne savoit pour ainsi dire à quoi se résoudre, étant combattu d’un côté par leurs raisons, et de l’autre par la parole qu’il avoit donnée aux parens de M. de Lauzun, Monsieur joignit ses remontrances à celles de ces princes, et l’obligea à se rétracter. Madame de Montespan, de son côté, quoiqu’elle parût agir ouvertement pour M. de Lauzun, tâchoit en secret de rompre son affaire, craignant que, s’il étoit une fois allié à la maison royale, il ne prît encore bien plus d’ascendant sur l’esprit du grand Alcandre, sur lequel elle vouloit régenter toute seule.
Le grand Alcandre avoit cependant tant de foiblesse pour M. de Lauzun, qu’il ne savoit comment lui annoncer sa volonté. Mais comme c’étoit une nécessité de le faire, il le fit entrer dans son cabinet, et lui dit là qu’après avoir bien fait réflexion sur son mariage, il ne vouloit pas qu’il s’achevât ; qu’en toute autre chose il lui donneroit des marques de son affection, mais qu’il ne lui devoit plus parler de celle-là, s’il avoit dessein de se maintenir dans ses bonnes grâces.
M. de Lauzun, reconnoissant à ce langage que quelqu’un l’avoit desservi auprès de lui, ne crut pas devoir s’efforcer de le fléchir, s’imaginant bien que cela seroit inutile ; mais, s’en allant en même temps chez madame de Montespan, qu’il soupçonnoit, il lui dit tout ce que la rage et la passion peuvent faire dire d’emporté et d’extravagant. Il lui dit qu’il avoit eu tort de se confier en une femme de sa sorte, puisqu’il devoit savoir que celles qui lui ressembloient, ayant fait banqueroute à leur honneur, la pouvoient bien faire à leurs amans ; qu’il alloit employer tout le crédit qu’il avoit sur le grand Alcandre pour le faire revenir d’un amour qui le perdoit de réputation dans le monde, et dont il ne connoissoit pas l’indignité.
Il lui dit encore plusieurs choses de la même force ; après quoi il s’en fut chez mademoiselle de Montpensier, à qui il annonça la volonté du grand Alcandre. Cette princesse, qui s’attendoit à des douceurs après lesquelles il y avoit nombre d’années qu’elle soupiroit, n’eut pas plutôt appris cette nouvelle qu’elle tomba évanouie, de sorte que toute l’eau de la Seine n’auroit pas été capable de la faire revenir, si M. de Lauzun n’eût approché son visage contre le sien pour lui dire à l’oreille qu’il n’étoit pas temps de se désespérer ainsi, mais de prendre des mesures qui les pussent mettre à couvert l’un et l’autre de la haine de leurs ennemis ; que cela ne consistoit cependant que dans une extrême diligence, parce que la perte d’un seul moment entraînoit une étrange suite ; que, pour lui, il étoit d’avis que, sans s’arrêter aux ordres du grand Alcandre, ils se mariassent secrètement ; que, quand la chose seroit faite, il y consentiroit bien, puisqu’il y avoit déjà consenti, et qu’en tout cas cela n’empêcheroit pas toujours leur intelligence et leur commerce.
La princesse revint de sa pamoison à un discours si éloquent et si agréable ; et, s’étant enfermés tous deux dans un cabinet, ils y appelèrent la comtesse de Nogent en tiers, qui leur confirma qu’ils ne pouvoient prendre une résolution plus avantageuse au bien de leurs affaires et à leur contentement. On dit même qu’elle fut d’avis qu’ils devoient consommer leur mariage d’avance, et, comme ils déféroient beaucoup à ses avis, la chose fut exécutée sur-le-champ. Après cela on convint, dans ce conseil d’amour, que la princesse iroit trouver le grand Alcandre, pour essayer si elle ne pourroit point lui faire changer de sentiment ; et en effet, elle monta en carrosse en même temps pour y aller.
Le grand Alcandre, étant averti qu’elle demandoit à lui parler en particulier, se douta bien de ce que ce pouvoit être ; et, quoiqu’il ne fût pas résolu de lui accorder sa demande, comme il ne pouvoit honnêtement se dispenser de lui donner audience, il la fit entrer dans son cabinet, après en avoir fait sortir tous ceux qui y étoient avec lui. La princesse se jeta là à ses pieds ; et, se cachant le visage de son mouchoir, moins cependant pour essuyer ses larmes que pour cacher sa confusion, elle lui dit qu’elle faisoit là un personnage qui la devoit combler de honte, si lui-même ne lui avoit donné de la hardiesse, approuvant comme il avoit fait les desseins de M. de Lauzun ; que c’étoit sur cela qu’elle avoit pris des engagemens qu’il lui étoit difficile de rompre ; que, quoiqu’il ne fût pas trop bienséant à une personne de son sexe de parler de la sorte, le mérite de M. de Lauzun, à qui il n’avoit pu refuser lui-même ses affections, pouvoit bien lui servir d’excuse ; qu’enfin, quiconque considéreroit que ses feux étoient légitimes et approuvés par son Roi n’y trouveroit peut-être pas tant à redire que l’on pourroit bien s’imaginer.
Le grand Alcandre, qui lui avoit commandé plusieurs fois de se lever sans qu’elle eût voulu lui obéir, lui dit, voyant qu’elle avoit cessé de parler, que, si elle ne se mettoit dans une autre posture, il n’a voit rien à lui répondre. La princesse se leva, l’entendant parler de la sorte, et attendant avec une crainte inconcevable l’arrêt de sa mort ou de sa vie. Mais le grand Alcandre ne la laissa pas longtemps dans l’incertitude, lui disant que, s’il avoit eu la foiblesse de consentir à son mariage, il en étoit assez puni par les remords qu’il en avoit ; que c’étoit une chose dont il se repentiroit toute sa vie, et qu’il ne concevoit pas comment elle, qui avoit toujours fait paroître un courage au-dessus de son sexe, se pouvoit résoudre à une action qui la devoit combler d’infamie.
Mademoiselle de Montpensier, ayant eu cette réponse, s’en retourna chez elle la rage dans le cœur contre le grand Alcandre ; et, y ayant trouvé M. de Lauzun, qui attendoit avec impatience des nouvelles de ce qu’elle auroit fait, ils convinrent ensemble que, puisque rien n’étoit capable de le fléchir, ils devoient, pour achever leur mariage, y faire mettre les cérémonies. Un prêtre fut bientôt trouvé pour cela ; et, ayant été épousés dans le cabinet de la princesse, ils attendirent du temps et de la fortune quelque occasion favorable pour divulguer leur mariage.
Cependant il ne put être fait si secrètement que le grand Alcandre n’en fût averti par un domestique de la princesse, que M. de Louvois [24], ennemi juré de M. de Lauzun, avoit gagné pour l’avertir de tout ce qui se passeroit dans sa maison [25]. Le grand Alcandre en témoigna une grande colère. M. de Louvois et madame de Montespan, qui étoient d’intelligence ensemble pour l’abaissement de M. de Lauzun, tâchèrent encore de l’animer davantage ; car il faut savoir que M. de Lauzun avoit maltraité M. de Louvois en plusieurs rencontres, et que ce ministre, qui commençoit déjà à entrer en grande faveur, cherchoit à s’en venger par toutes sortes de moyens.
Ils conseillèrent néanmoins au grand Alcandre de dissimuler son ressentiment, soit qu’ils crussent ne pouvoir encore procurer la perte de M. de Lauzun, ou qu’ils appréhendassent de choquer la princesse, qui ne pardonnoit pas volontiers quand on lui avoit donné une fois sujet de vouloir du mal. Le Roi continua donc d’en user en apparence avec lui comme il faisoit auparavant ; mais il donna ordre à M. de Louvois de le faire observer de si près qu’il pût lui rendre compte de sa conduite.
M. de Lauzun, cependant, prenant des airs de grandeur avec sa nouvelle épouse, auxquels il n’avoit déjà que trop de disposition naturellement, s’en faisoit accroire tous les jours de plus en plus, si bien qu’il avoit presque toute la cour pour ennemie. Il soutenoit cependant tout cela avec une hauteur extraordinaire ; mais il lui survint bientôt une occasion qui fut cause de sa disgrâce, que l’on méditoit néanmoins il y avoit déjà longtemps.
Le comte de Guiche [26], fils aîné du maréchal de Grammont, étoit colonel du régiment des gardes du grand Alcandre, en survivance de son père, et le grand Alcandre l’ayant exilé pour des desseins approchans de ceux de M. de Lauzun, c’est-à-dire pour avoir osé aimer la femme de Monsieur, enfin, à la considération du maréchal, pour qui le grand Alcandre avoit beaucoup d’amitié, il permit à son fils de revenir, à condition néanmoins qu’il se déferoit de sa charge. Or, la charge du comte de Guiche étant sans contredit la plus belle et la plus considérable de toute la cour [27], ceux qui avoient du crédit auprès du grand Alcandre y prétendoient ; M. de Lauzun entre autres, que le grand Alcandre avoit fait il n’y avoit pas long-temps capitaine de ses gardes. Cependant il n’osoit la lui demander, soit qu’il se fût aperçu qu’il commençoit à n’être plus si bien dans son esprit qu’il avoit été autrefois, ou qu’il ne voulût pas à toute heure et à tous momens l’importuner de nouvelles grâces.
Il avoit fait la paix en apparence avec madame de Montespan, qui, pour le faire donner plus adroitement dans le panneau, avoit fait semblant de lui pardonner. M. de Lauzun, croyant donc qu’elle ne lui refuseroit pas son entremise, la pria de vouloir le servir en cette rencontre, mais de ne pas dire au grand Alcandre qu’il lui eût fait cette prière. Madame de Montespan le lui promit ; mais, allant en même temps trouver le grand Alcandre, elle lui dit que M. de Lauzun n’étoit plus rien que mystère ; qu’il lui avoit fait promettre de lui demander la charge du comte de Guiche, mais qu’il avoit exigé en même temps de ne lui pas dire qu’il l’en avoit priée ; qu’elle ne concevoit pas pourquoi tous ces détours avec un prince qui l’avoit comblé de tant de grâces, et qui l’en combloit encore tous les jours ; que, quoiqu’ il n’y eût pas lieu de croire qu’il avoit pu avoir de méchants desseins en demandant cette charge, néanmoins elle ne la lui accorderoit pas si elle étoit à sa place, puisque toutes les bontés qu’il avoit pour lui méritoient bien du moins que pour toute reconnoissance il fît paroître plus de franchise.
Quoique le procédé de M. de Lauzun ne fût rien dans le fond, comme madame de Montespan néanmoins y donnoit les couleurs les plus noires qu’il lui étoit possible, le grand Alcandre y fit réflexion, et, témoignant à madame de Montespan qu’il ne pouvoit comprendre le dessein que M. de Lauzun pouvoit avoir, elle lui conseilla de lui en parler lui-même, pour voir s’il useroit toujours des mêmes détours. Le grand Alcandre approuva ce conseil, et, s’étant enfermé avec M. de Lauzun dans son cabinet, après lui avoir parlé de choses et d’autres, il l’entretint de tous ceux qui aspiroient à la charge du comte de Guiche, lui disant que son dessein n’étoit pas d’en gratifier aucun, parce qu’ils ne lui sembloient pas avoir assez d’expérience pour remplir une si grande charge.
M. de Lauzun, ravi de voir le grand Alcandre dans ces sentimens, tâcha de l’y confirmer, ajoutant à ce qu’il avoit dit de ces personnes-là quelque chose à leur désavantage. Mais, comme il ne venoit point à ce que le grand Alcandre désiroit de lui, c’est-à-dire à lui demander si elle ne l’accommoderoit pas, et s’il n’avoit pas envie de l’avoir lui-même, M. de Lauzun lui répondit qu’après avoir reçu tant de grâces de Sa Majesté, il n’avoit garde d’en prétendre de nouvelles ; qu’ainsi il osoit lui assurer qu’il n’en avoit pas eu seulement la pensée, se rendant assez de justice pour savoir qu’il y en avoit mille autres qui en étoient plus dignes que lui. — Cette modestie vous sied bien, répondit un peu froidement le grand Alcandre ; à quoi il ajouta que cependant madame de Montespan lui avoit parlé pour lui, ce qu’il ne croyoit pas qu’elle eût fait s’il ne l’en avoit priée ; qu’il ne concevoit pas pourquoi il faisoit mystère d’une chose à laquelle il pouvoit prétendre préférablement à tant d’autres, et qu’il vouloit qu’il lui en dît la vérité. M. de Lauzun, se voyant pressé de cette sorte par le grand Alcandre, lui jura tout de nouveau qu’il n’y avoit jamais pensé ; sur quoi le grand Alcandre, prenant tout d’un coup un air à le faire trembler, lui dit qu’il s’étonnoit extrêmement de la hardiesse qu’il avoit de lui mentir avec tant d’impudence ; qu’il n’avoit que faire de déguiser davantage ; que madame de Montespan lui avoit tout dit, et qu’il pouvoit s’assurer qu’il n’auroit jamais aucune confiance en tout ce qu’il lui pourroit dire. En même temps il se leva, et l’ayant congédié sans vouloir entendre ses excuses, M. de Lauzun s’en alla plein de désespoir et de rage.
Il rencontra, au sortir du cabinet du grand Alcandre, le duc de Créqui [28], qui, le voyant tout changé, lui demanda ce qu’il avoit ; à quoi il lui répondit qu’il étoit un malheureux, qu’il avoit la corde au cou, et que celui qui voudroit l’étrangler seroit le meilleur de ses amis. Il s’en fut de là chez madame de Montespan, où il n’y eut sorte d’injures qu’il ne lui dît, et même de si grossières, qu’on n’eût jamais cru que c’étoit un homme de qualité qui les eût pu avoir à la bouche. Madame de Montespan lui dit que, si ce n’étoit qu’elle espéroit que le grand Alcandre lui en feroit justice, elle le dévisageroit à l’heure même, mais qu’elle vouloit bien s’en remettre à lui.
Après qu’il lui eut encore dit tout ce que le désespoir et la rage peuvent inspirer de plus sale et de plus vilain, il s’en fut chez mademoiselle de Montpensier, qu’il ne put caresser comme il avoit accoutumé, tant l’abattement de l’esprit avoit contribué à celui du corps. Cependant, comme la princesse n’y trouvoit pas son compte, elle voulut savoir d’où cela provenoit, lui jurant que la chose seroit bien difficile si elle ne tâchoit d’y apporter remède. M. de Lauzun, se croyant obligé de lui dire ce que c’étoit, lui fit part de la conversation qu’il avoit eue avec le grand Alcandre, et de la visite qu’il avoit rendue ensuite à madame de Montespan, ne lui cachant rien de tout ce qu’il lui avoit dit de désobligeant.
La princesse, à qui l’âge avoit donné plus d’expérience qu’à lui, qui naturellement avoit beaucoup d’esprit, mais fort peu de jugement, le blâma de ce qu’il avoit fait, lui disant que toutes vérités n’étoient pas toujours bonnes à dire. Elle appréhenda le ressentiment du grand Alcandre, et, dans la crainte qu’elle avoit que cette conjoncture ne fût nuisible à ses plaisirs, elle fit ce qu’elle put pour en prendre toujours par provision, de peur qu’il ne lui fût pas permis d’en prendre toutes fois et quantes qu’elle en auroit la volonté.
Eh effet, le grand Alcandre ayant su que M. de Lauzun, nonobstant ses ordres réitérés tant de fois, s’étoit encore déchaîné contre madame de Montespan, résolut de le faire arrêter [29]. Les remontrances de M. de Louvois, qui ne cessoit de lui représenter qu’il ne pourroit ramener autrement cet esprit à la raison, y servirent beaucoup. Enfin, après avoir vaincu tous les retours qu’il avoit encore pour cet indigne favori, l’ordre en fut donné au chevalier de Fourbin [30], major des gardes du corps, qui se transporta à l’heure même chez M. de Lauzun, où, ayant appris qu’il étoit allé à Paris, il laissa un garde en sentinelle à la porte, avec ordre de le venir avertir dès le moment qu’il seroit revenu. M. de Lauzun arriva une heure après, et le garde en étant venu avertir le chevalier de Fourbin, il posa des gardes autour de la maison, puis entra dedans et le trouva auprès du feu, qui ne songeoit guère à son malheur, car d’aussi loin qu’il le vit venir, il s’enquit de lui ce qui l’amenoit, et s’il ne venoit point de la part du grand Alcandre pour lui dire de le venir trouver. Le chevalier de Fourbin répondit que non, mais qu’il lui envoyoit demander son épée ; qu’il étoit fâché d’être chargé d’une telle commission, mais que, comme il étoit obligé de faire ce que son maître lui commandoit, il n’avoit pu s’en dispenser.
Il est aisé de juger de la surprise de M. de Lauzun à un compliment, si peu attendu ; car, quoiqu’il eût donné lieu au grand Alcandre d’en user encore plus rigoureusement avec lui, comme on ne se rend jamais justice, et que d’ailleurs on se flatte toujours, il croyoit que l’amitié qu’il lui avoit toujours témoignée prévaudroit pardessus son ressentiment. Il demanda au chevalier de Fourbin s’il n’y avoit pas moyen qu’il lui pût parler ; mais lui ayant dit que cela lui étoit défendu, il s’abandonna au désespoir. On le garda à vue pendant toute la nuit, comme on eût pu faire l’homme du monde le plus criminel ; et le chevalier de Fourbin l’ayant remis le lendemain entre les mains de M. d’Artagnan [31], capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires du grand Alcandre, M. de Lauzun se crut perdu, parce que M. d’Artagnan n’avoit jamais été de ses amis. Ainsi, il se mit dans l’esprit qu’on ne l’avoit choisi que pour lui faire pièce ; inférant en même temps que, pour le traiter avec tant de cruauté, il falloit que ses ennemis eussent prévalu entièrement sur l’esprit du grand Alcandre.
M. d’Artagnan, ayant pris les ordres de M. de Louvois, par le commandement du grand Alcandre, conduisit M. de Lauzun à Pierre-Encise, et de là à Pignerolles [32], où on l’enferma dans une chambre grillée, ne lui laissant parler à qui que ce soit, et n’ayant que des livres pour toute compagnie, avec son valet de chambre, à qui l’on annonça que, s’il vouloit demeurer avec lui, il falloit se résoudre à ne point sortir. Le chagrin qu’il eut de se voir tombé d’une si haute fortune dans un état si déplorable, le réduisit bientôt à une telle extrémité qu’on désespéra de sa vie. Il tomba même en léthargie ; de sorte qu’on dépêcha un courrier au grand Alcandre pour lui donner avis de sa mort. Mais, six heures après, il en vint un autre qui apprit sa résurrection, dont on ne témoigna ni joie ni chagrin, j’entends dans le général, chacun le comptant déjà comme un homme mort au monde, ce qui faisoit qu’on n’y prenoit plus d’intérêt.
Cependant, mademoiselle de Montpensier, étant au désespoir que les plaisirs à quoi elle s’étoit attendue avec lui fussent disparus si tôt, souffroit d’autant plus qu’elle osoit moins le faire paroître. Ses bonnes amies faisoient cependant tout ce qu’elles pouvoient pour adoucir sa douleur ; mais comme elles n’étoient pas toujours avec elle, et surtout la nuit, pendant laquelle la maladie qu’elle avoit est toujours la plus pressante, elles contribuoient plutôt à la rendre plus malheureuse, en la faisant ainsi ressouvenir de son malheur, qu’elles ne lui apportoient du soulagement. Son plus grand mal étoit cependant de n’oser se plaindre ; car, comme son mariage étoit secret, elle jugeoit bien qu’il falloit que ses peines fussent secrètes, si elle ne vouloit se résoudre d’apprêter à rire, non seulement à ses ennemis, mais encore à toute la France, qui avoit les yeux tournés sur elle pour voir de quelle façon elle recevroit la disgrâce de son bon ami. Cela ne l’empêcha pourtant pas de prendre l’homme d’affaires de M. de Lauzun, dont elle fit son intendant, et de recevoir à son service son écuyer et ses plus fidèles domestiques, qui furent ravis de pouvoir surgir à ce port après le naufrage de leur maître.
Cependant le grand Alcandre, ni plus ni moins que si M. de Lauzun n’eût jamais été son favori, écoutoit tout ce qu’on lui en disoit sans en être touché, et même sans y répondre ; ce qui étoit cause que ceux qui étoient encore de ses amis, dont le nombre néanmoins étoit très petit, n’osoient plus lui en parler. On n’osoit même presque plus lui demander la charge du comte de Guiche, parce que, chacun sachant que ç’avoit été là la pierre d’achoppement, on craignoit qu’elle ne fît le même effet pour les autres qu’elle avoit fait pour lui. Comme on étoit cependant tous les jours dans l’attente pour voir à qui le grand Alcandre la donneroit, on fut tout surpris qu’un matin, à son lever, il dit au duc de La Feuillade [33], que, s’il pouvoit trouver cinquante mille écus, il lui donneroit le reste pour avoir la charge du comte de Guiche, à qui il falloit compter six cent mille francs avant d’avoir sa démission. Le duc de la Feuillade répondit en riant au grand Alcandre qu’il les trouveroit bien s’il lui vouloit servir de caution ; et après l’avoir remercié sérieusement de la grâce qu’il lui faisoit, il prit congé de lui pour aller chercher à Paris la somme qu’il lui demandoit.
Comme la nouvelle de ce que le grand Alcandre faisoit pour lui s’étoit répandue parmi les courtisans, il en trouva un grand nombre dans l’antichambre et sur le degré, qui lui en vinrent faire leurs complimens. Mais les ayant à peine écoutés, il s’en retourna avec son air brusque dans la chambre du grand Alcandre, à qui il dit qu’on n’avoit plus que faire d’avoir recours aux saints pour voir des miracles ; que Sa Majesté en faisoit de plus grands que tous les saints du paradis ; que quand il étoit arrivé le matin à son lever, il n’avoit été regardé de personne, parce que personne ne croyoit que Sa Majesté dût faire ce qu’elle avoit fait pour lui ; mais que chacun n’avoit pas plustôt entendu la grâce qu’elle lui avoit accordée, qu’on s’étoit empressé à l’envi l’un de l’autre de lui faire des offres de service, mais des offres de service à la mode de la cour, c’est-à-dire sans que pas un lui eût offert sa bourse pour y pouvoir prendre les cinquante mille écus dont il avoit tant de besoin.
Le grand Alcandre se mit à rire de la saillie du duc de la Feuillade, et, voyant qu’il s’en retournoit avec autant de précipitation qu’il étoit venu, il lui dit de ne s’en pas aller si vite, s’il n’avoit que faire à Paris que pour aller chercher de l’argent ; qu’il consentoit de lui en prêter, mais à condition qu’il le lui rendroit quand il se trouveroit en état. Ainsi le grand Alcandre, ayant abaissé en un jour son favori, en éleva un autre presque en aussi peu de temps : car il est constant que le matin que le grand Alcandre fit ce présent au duc de la Feuillade, il étoit si mal dans ses affaires, que, lui étant mort un de ses chevaux de carrosse, il n’avoit point trouvé d’argent chez lui pour en ravoir un autre.
Quoique la disgrâce de M. de Lauzun eût privé les dames de la cour d’un de leurs meilleurs combattans, comme, d’un moment à l’autre, il s’en présente là de tout frais, la vigueur de ceux-ci les consola de la perte de l’autre, et elles ne l’eurent pas plutôt perdu de vue qu’elles ne songèrent plus à ses bravoures. Parmi les jeunes gens qui se présentèrent pour remplir sa place, le duc de Longueville [34] étoit sans doute le plus considérable pour le bien et pour la naissance : car il descendoit de princes qui avoient possédé la couronne avant qu’elle tombât dans la branche du grand Alcandre, et il avoit bien six cent mille livres de rente en fonds de terre pour soutenir une origine si illustre. Pour ce qui est de sa personne, sa jeunesse, accompagnée d’un je ne sais quoi, la rendoit toute charmante. Ainsi, quoiqu’il ne fût ni de si belle taille ni de si grand air que beaucoup d’autres, il ne laissoit pas de plaire généralement à toutes les femmes : de sorte qu’il ne parut pas plutôt à la cour qu’elles firent toutes des desseins sur sa personne.
La maréchale de La Ferté [35] fut de celles-là, et, trente-sept ou trente-huit ans [36] qu’elle avoit sur la tête ne lui permettant pas d’espérer qu’il la préférât à tant d’autres qui étoient plus jeunes et plus belles qu’elle, elle crut qu’elle ne feroit point mal de lui faire quelques avances, et que les avances pourroient lui tenir lieu de mérite. Comme on jouoit chez elle, et que c’étoit le rendez-vous de tous les honnêtes gens et de tous ceux qui n’avoient que faire, elle pria le duc de Longueville [37] de la venir voir ; et, lui ayant marqué une heure, pour le lendemain, où il ne devoit encore y avoir personne, elle eut le plaisir de l’entretenir tout à son aise. Cependant ce fut avec peu de profit, car le jeune prince étoit encore si neuf dans les mystères amoureux, qu’il n’entendit ni ce que cent œillades ni ce que cent minauderies lui vouloient dire, et qui en eussent néanmoins assez averti un autre qui en auroit été mieux instruit que lui.
Cependant, comme la maréchale, toute vieille qu’elle étoit, ne lui avoit pas déplu, il la fut revoir le lendemain à la même heure ; et, la trouvant à sa toilette, il lui dit qu’il lui vouloit faire présent d’une poudre admirable. La maréchale lui demanda quelle poudre c’étoit, et, le duc de Longueville lui ayant dit que c’étoit de la poudre de Polleville [38], à peine eut-il lâché la parole qu’elle s’écria qu’elle le dispensoit de lui en envoyer ; que c’étoit une poudre abominable, et qu’il faudroit faire brûler celui qui l’avoit inventée. Elle demanda aussitôt au duc de Longueville s’il s’en servoit, et, le duc lui ayant dit qu’oui, elle lui dit de ne la pas approcher, et que cette poudre étoit pire que la peste. Le duc, qui ne savoit ce que cela vouloit dire, la pria de lui expliquer cette énigme ; et, la maréchale lui demandant s’il n’avoit pas entendu parler de ce qui étoit arrivé au comte de Saulx [39], comme il lui eut répondu que non, elle lui dit qu’il n’avoit qu’à le lui demander à lui-même, et qu’après cela elle ne croyoit pas qu’il mît encore de la poudre de Polleville.
Elle ne voulut jamais lui rien dire davantage jusques à ce qu’elle fût coiffée ; mais, celle qui la coiffoit s’en étant allée, elle lui dit, après cela, que, le comte de Saulx ayant eu un rendez-vous avec madame de Cœuvres [40], il n’en étoit pas sorti à son honneur à cause du Polleville, et qu’elle croyoit bien qu’il lui en pourroit arriver autant s’il se trouvoit en pareille rencontre. Ce reproche fit rire le duc de Longueville, et, comme la force de sa jeunesse lui faisoit croire qu’il ne haïssoit pas là maréchale, qu’il avoit trouvée jolie femme à son miroir, il lui dit qu’il avoit mis ce jour-là du Polleville, mais qu’il parieroit bien qu’il ne lui arriveroit pas le même accident qui étoit arrivé au comte de Saulx. Là-dessus, il se mit en état de la caresser, et la maréchale, feignant de lui savoir mauvais gré de sa hardiesse, pour l’animer encore davantage, se défendit jusques à ce qu’elle fût proche d’un lit, où elle se laissa tomber. Elle éprouva là que ce qui se disoit du comte de Saulx étoit un effet de sa foiblesse, et non pas du Polleville, comme il avoit été bien aise de le faire accroire.
Le duc de Longueville, ravi de son aventure, en usa en jeune homme, ce qui ne déplut pas à la maréchale, qui lui recommanda le secret, lui faisant entendre qu’elle avoit affaire à un mari difficile et qui n’entendroit point de raillerie s’il venoit à découvrir qu’ils eussent commerce ensemble. Le duc de Longueville lui promit d’en user sagement, et qu’elle auroit lieu d’en être contente ; mais il lui recommanda, de son côté, de ne lui point faire d’infidélité, ajoutant qu’il l’abandonneroit dès le moment qu’il en reconnoîtroit la moindre chose.
Cette loi fut dure pour la maréchale, qui avoit cru jusque-là qu’un homme étoit trop peu pour une femme ; mais, comme elle aimoit le duc, et que d’ailleurs elle venoit d’éprouver qu’il ne s’en falloit pas de beaucoup qu’il n’en valût deux autres, elle résolut de faire effort sur son naturel et de lui tenir parole tant qu’elle le pourroit. Ainsi, dès ce jour-là, elle congédia le marquis d’Effiat [41], qui tâchoit de se mettre bien auprès d’elle, et qui y auroit bientôt réussi sans la défense du duc de Longueville.
Le marquis d’Effiat étoit un petit homme têtu, brave, quoiqu’il n’aimât pas la guerre, adonné à ses plaisirs et peu capable de raison quand il s’étoit mis une fois une chose en tête. Il trouva de la dureté dans le commandement de la maréchale, avec qui il s’étoit vu à la veille de la conclusion ; et, ne doutant point qu’il n’y eût quelque autre amant en campagne, il soupçonna aussitôt le duc de Longueville. Ses soupçons étant tombés sur lui, quoique cette dame en vît bien d’autres, il fut fâché d’avoir affaire à un prince avec qui il n’osoit se mesurer sans s’exposer à d’étranges suites. Cependant, sa passion étant plus forte que sa raison, il vouloit, ayant que de le quereller, savoir au vrai s’il ne se méprenoit pas ; et, ayant mis pour cela des espions en campagne, il fut averti d’un rendez-vous que ces amans avoient pris ensemble, et il se trouva lui-même devant la porte en gros manteau, afin d’être plus sûr si cela étoit vrai ou non. Comme il eut vu de ses propres yeux qu’on ne lui avoit dit que la vérité, il résolut de quereller le duc de Longueville à la première occasion ; et, l’ayant rencontré bientôt après, il lui dit à l’oreille qu’il le vouloit voir l’épée à la main. Le duc de Longueville lui répondit, sans s’émouvoir, qu’il devoit apprendre à se connoître ; qu’il se pouvoit battre contre ses égaux, mais que, pour lui, il avoit appris à ne se jamais commettre avec des gens dont il n’y avoit pas longtemps qu’on connoissoit les ancêtres.
Ce reproche fut sensible au marquis d’Effiat, de l’extraction duquel l’on n’avoit pas grande opinion dans le monde [42]. Cependant, comme il n’étoit pas tout seul dans l’endroit où il avoit parlé au duc de Longueville, il s’éloigna sans faire semblant de rien et sans même donner aucun soupçon de ce qu’il lui avoit dit. Le duc de Longueville sortit peu de temps après ; mais comme il avoit quantité de pages et de laquais à sa suite, d’Effiat crut à propos d’attendre une occasion plus favorable pour tirer raison et de l’injure qu’il venoit de recevoir et du vol qu’il lui avoit fait de sa maîtresse.
Cependant le duc de Longueville, voyant que d’Effiat n’étoit point venu après lui, prit pour un effet de son peu de courage ce qui n’étoit qu’un effet de son jugement, si bien qu’il commença à en faire des médisances, lesquelles étant rapportées à d’Effiat le mirent dans un tel excès de colère qu’il résolut de se perdre ou d’en tirer vengeance. Pour cet effet il dépêcha deux ou trois espions pour savoir quand le duc de Longueville sortiroit tout seul, ce qui lui arrivoit souvent, ayant, outre l’intrigue de la maréchale, quelques amourettes en ville qui lui donnoient de l’occupation. Deux ou trois jours après, un de ces espions l’étant venu avertir que le duc étoit sorti tout seul en chaise, et étoit allé à quelque découverte, il se fut poster sur son chemin, tellement que, comme il s’en revenoit à deux heures après minuit, il se présenta devant lui, tenant un bâton d’une main et l’épée de l’autre, lui criant de sortir de sa chaise, sinon qu’il le maltraiteroit. Le duc de Longueville, ayant fait en même temps arrêter ses porteurs, voulut mettre l’épée à la main ; mais d’Effiat le chargeant devant qu’il eût le temps de la tirer du fourreau, il lui donna quelques coups de cannes ; ce que voyant les porteurs, ils tirèrent les bâtons de la chaise et alloient assommer d’Effiat, s’il n’eût jugé à propos d’éviter leur furie par une prompte fuite.
Il est aisé de comprendre le désespoir du duc après un affront si sensible, et combien il désira de se venger. Il défendit aux porteurs de chaise de parler jamais de cette aventure, et n’en parlant lui-même qu’à un de ses bons amis, celui-ci lui conseilla de se donner de garde de s’en plaindre : car, quoique le grand Alcandre n’eût pas manqué d’en faire une punition exemplaire, comme il ne croyoit pas qu’un prince à qui on avoit fait un tel affront pût se venger par le ministère d’autrui, il lui dit qu’il n’y avoit rien à faire que de faire assassiner son ennemi. En effet, c’étoit le seul parti qu’il y avoit à prendre en cette occasion : car, quoiqu’il ne soit pas généreux de faire des actions de cette nature, toutefois, comme c’eût été s’exposer à être battu que de prendre d’Effiat en brave homme, il n’étoit pas juste, et surtout à un prince, de recevoir deux affronts en un même temps.
Quoi qu’il en soit, le duc s’étant déterminé à suivre ce conseil, il ne chercha plus que les occasions de le faire réussir. Mais c’étoit une chose bien difficile, parce que d’Effiat, après avoir fait une pareille folie, n’alloit plus que bien accompagné et se tenoit sur ses gardes.
Cependant il arriva que la maréchale de La Ferté devint grosse, ce [43] qui alarma extrêmement cette dame : car il faut savoir qu’elle ne couchoit point avec son mari, qui étoit un vieux goutteux, grand chemin du cocuage, surtout quand on a une femme de bon appétit, comme étoit la maréchale.
Ainsi elle s’imaginoit avec raison que, s’il venoit à le savoir, il l’enfermeroit aussitôt pour toute sa vie, si bien qu’il lui fallut user de grande précaution pour le lui cacher. Mais elle le découvrit au duc de Longueville, qui, ravi de se voir renaître, quoiqu’il ne fût encore qu’un enfant lui-même, en aima plus tendrement la maréchale. Comme elle fut grosse de quatre ou cinq mois, elle ne voulut plus se commettre à aller dans la chambre du maréchal, et, demeurant à jouer toute la nuit, elle restoit le jour au lit, où elle se faisoit apporter à manger, et ne se levoit point que les joueurs ne revinssent, devant qui elle ne bougeoit point de son fauteuil, de peur qu’ils ne vinssent à découvrir le sujet de ses inquiétudes.
Quoique le maréchal ne se défiât de rien, il ne laissa pas de trouver à redire à cette manière de vivre, et, lui ayant fait dire qu’il seroit bien aise de lui parler, elle se hasarda à venir dans sa chambre, où il lui lava la tête comme il faut. Mais la maréchale, qui ne demandoit qu’un prétexte pour n’y plus revenir, feignant d’être fort offensée de ses corrections, les reçut tout en colère ; si bien que la conversation s’échauffant de paroles à autres, ils se dirent l’un et l’autre beaucoup de pauvretés : ce qui donna lieu à la maréchale de lui dire qu’elle lui permettoit de la quereller quand elle le reviendroit voir. Et, sortant en même temps de la chambre, elle n’y remit le pied qu’après ses couches.
Comme elle fut à six semaines ou deux mois près de son terme, elle feignit une indisposition pour se délivrer de la compagnie qui l’accabloit. Enfin, le terme étant venu, elle accoucha [44] dans sa maison, tout de même que si elle eût été grosse de son mari.
Ce fut Clément qui l’accoucha, et le duc de Longueville, qui étoit présent à l’accouchement, lui fit promettre le secret, moyennant deux cents pistoles qu’il lui donna.
Cependant il venoit souvent de pareilles aubaines à cet accoucheur ; car peu de temps après, madame de Montespan étant encore devenue grosse du grand Alcandre [45], on eut recours à lui ; de sorte qu’on le fut quérir de la même manière et avec la même cérémonie qu’on avoit fait la première fois. Il y eut cependant de la distinction dans la récompense, car on lui donna cette fois-là deux cents louis d’or, au lieu qu’on ne lui en avoit donné que cent la première fois. L’on observa toujours la même chose tant que l’on eut besoin de lui, ayant eu jusqu’à quatre cents louis d’or pour le quatrième enfant dont il accoucha madame de Montespan. Mais, soit que cela parût violent à cette dame, qui naturellement étoit fort ménagère, ou qu’elle en eût d’autres raisons, le grand Alcandre l’ayant encore laissée grosse quelque temps après, et étant obligé de s’en aller en campagne, elle envoya marchander avec Clément pour lui envoyer un de ses garçons à Maintenon, où elle avoit résolu d’aller accoucher. Elle passa là pour une des bonnes amies de la marquise de Maintenon [46], si bien que le garçon qui l’accoucha ne sut pas qu’il avoit accouché la maîtresse du grand Alcandre.
Cependant, pour revenir au duc de Longueville, comme il n’épioit, comme j’ai déjà dit, que l’occasion de se venger de d’Effiat, il fut obligé de se préparer à suivre le grand Alcandre, qui avoit déclaré la guerre aux Hollandois. Cette campagne fut extrêmement glorieuse à ce grand prince, mais fatale à ce duc : car, s’étant amusé à faire la débauche une heure ou deux avant que le grand Alcandre fît passer le Rhin à ses troupes, le vin lui fit tirer mal à propos un coup de pistolet contre les ennemis, qui parloient déjà de se rendre ; ce qui fut cause que ceux-ci firent leur décharge sur lui et sur les principaux de l’armée du grand Alcandre, dont il y en eut beaucoup de tués, et lui entre autres, qui étoit cause de ce malheur [47].
La nouvelle en étant portée à Paris, la maréchale en pensa mourir de douleur, aussi bien que plusieurs autres dames [48] qui prenoient intérêt à sa personne. Il fut regretté d’ailleurs généralement de tout le monde, excepté de d’Effiat, qui se voyoit délivré par là d’un puissant ennemi. En faisant l’inventaire de ses papiers, on trouva son testament, qu’il avoit fait avant que de partir, dans lequel on fut tout surpris de voir qu’il reconnoissoit le fils qu’il avoit eu de la maréchale pour être à lui, et lui laissoit cinq cent mille francs, en cas qu’il vînt à mourir devant que d’être marié.
Comme cette nouvelle fut bientôt publiée par toute la ville, la maréchale en fut avertie par madame de Bertillac [49], sa bonne amie, qui, en même temps, lui dit de prendre garde qu’elle ne vînt aux oreilles de son mari [50]. La maréchale pensa enrager, voyant que son affaire devenoit ainsi publique ; mais, comme le temps console de tout, elle soutint cela le mieux du monde, et s’accoutuma à la fin à en entendre parler sans en rougir. Le grand Alcandre, sachant que le duc de Longueville avoit un fils de la maréchale, en eut beaucoup de joye ; car, comme il y avoit du rapport entre l’aventure du duc de Longueville et la sienne, je veux dire, comme le fils que ce duc laissoit venoit d’une femme mariée aussi bien que ceux qu’il avoit de madame de Montespan, il voulut que cela lui servît de planche pour faire légitimer ses enfants quand la volonté lui en prendroit. Il envoya donc ordre au Parlement de Paris de légitimer le fils du duc de Longueville, sans qu’on fût obligé de nommer la mère, ce qui étoit néanmoins contre l’usage et contre les lois du royaume.
Quand les premiers bruits que cette nouvelle avoit apportés furent un peu apaisés, la maréchale, qui voyoit sa réputation perdue parmi tous les honnêtes gens, résolut de faire banqueroute à toute la pudeur qui lui pouvoit rester. Elle tâta de tous ceux qui voulurent bien se contenter des restes du duc de Longueville et du reste de plusieurs autres, et, ayant lié une forte amitié avec madame de Bertillac, qui étoit une des plus belles femmes de Paris, elles furent confidentes l’une de l’autre et goûtèrent de bien des sortes de plaisirs. La maréchale avoit un laquais qui fut roué, et qui avoit une des plus belles têtes du monde ; et la médisance vouloit qu’il eût part dans ses bonnes grâces, parce qu’on voyoit qu’elle le distinguoit des autres laquais.
Une si grande liaison de madame de Bertillac avec la maréchale ne plut pas à M. de Bertillac, son beau-père [51], qui craignoit que pendant que son fils étoit à l’armée, sa femme [52] ne vînt à se débaucher. Mais c’étoit une chose faite, et elle n’avoit pu entendre parler à la maréchale du plaisir qu’il y avoit à faire une infidélité à son mari, sans vouloir éprouver ce qui en étoit. M. de Bertillac y tenoit la main cependant autant qu’il lui étoit possible, avoit l’œil sur elle, et lui recommandoit d’avoir l’honneur en recommandation ; mais comme il étoit beaucoup occupé à la garde des trésors du grand Alcandre, que ce prince lui avoit confiés, autant il lui étoit difficile de pouvoir répondre de la conduite de sa belle-fille, autant il étoit aisé à sa belle-fille de lui en faire accroire.
Cependant madame de Bertillac étant allée un jour à la comédie avec la maréchale, comme celle-ci eut vu danser le Basque sauteur [53], elle dit à l’autre qu’elle s’imaginoit qu’un homme qui avoit les reins si souples étoit un admirable acteur, lui avouant en même temps qu’elle seroit ravie d’en faire l’expérience elle-même. L’ingénuité de la maréchale ayant obligé madame de Bertillac de lui parler aussi à cœur ouvert, elle dit qu’elle croyoit bien qu’il y auroit beaucoup de plaisir à faire ce qu’elle disoit, mais que pour elle, si elle étoit tentée de quelque chose, c’étoit de savoir si Baron [54], comédien, avoit autant d’agrément dans la conversation qu’il en avoit sur le théâtre. Cette confidence fut suivie de l’approbation de la maréchale ; elle releva le mérite de Baron, afin que madame de Bertillac relevât celui du Basque, et, s’encourageant toutes deux à tâter de cette aventure autrement que dans l’idée, elles ne furent pas plus tôt sorties de la comédie, qu’elles se résolurent d’écrire à ces deux hommes, pour les prier de leur accorder un moment de leur conversation.
Baron et le Basque furent surpris de l’honneur qu’on leur faisoit, et, n’ayant pas manqué d’y répondre civilement, l’entrevue se fit à St-Cloud [55], d’où les dames s’en revinrent si contentes qu’elles convinrent avec eux que ce ne seroit pas là la dernière fois qu’ils se verroient. Elles se firent part après cela l’une à l’autre de ce qui leur étoit arrivé, et elles furent obligées de tomber d’accord que ce n’étoit pas toujours des gens de qualité qu’on tiroit les plus grands services. À l’égard des hommes, ils n’eurent pas tous deux pareil sujet de contentement. Si Baron fut satisfait de sa fortune, il n’en fut pas de même du Basque, qui trouvoit que la maréchale étoit insatiable. Il dit à Baron que, quoiqu’il fatiguât beaucoup à la comédie, il aimeroit mieux être obligé d’y danser tous les jours, que d’être seulement une heure avec elle. Baron le consola sur le bonheur d’être bien avec une femme de grande qualité, et il fut assez fou pour se laisser repaître de cette chimère.
Cependant madame de Bertillac se laissa tellement aller à l’extravagance, qu’elle ne pouvoit plus être un moment sans Baron ; et, ayant su qu’il avoit perdu une somme fort considérable au jeu, elle le força à prendre ses pierreries, qui valoient bien vingt mille écus [56]. Mais il arriva, par malheur pour elle, qu’une des amies de son beau-père en ayant eu affaire pour quelque assemblée, elle le pria de les emprunter de sa belle-fille, et M. de Bertillac, étant bien aise d’obliger cette dame, dit à madame de Bertillac de les lui prêter, ce qui l’embarrassa extrêmement.
Comme d’abord elle avoit paru surprise, M. de Bertillac crut que, comme elle étoit joueuse, elle les avoit jouées ou engagées quelque part ; et, la pressant de lui dire où c’étoit, afin qu’il les pût retirer, elle s’embarrassa encore davantage, disant tantôt qu’elle les avoit prêtées à une de ses amies, tantôt qu’elles étoient chez le joaillier, qui les raccommodoit. M. de Bertillac, qui étoit homme d’expérience, vit bien qu’il y avoit quelque mystère là-dessous ; mais, n’en pouvant rien tirer davantage, il fut obligé de divulguer l’affaire dans la famille de sa belle-fille, qui la tourna de tant de côtés, qu’elle avoua à la fin qu’elle les avoit données à Baron, ce qu’elle tâcha néanmoins de déguiser sous le nom de prêter. Les parens furent en même temps chez ce comédien, qui nia d’abord la chose, croyant qu’on ne lui en parloit que par soupçon ; mais, sachant un moment après que c’étoit madame de Bertillac même qui avoit été obligée de le dire, et que même on en avoit déjà parlé au grand Alcandre, si bien que cela l’alloit perdre, il prit le parti de les rendre, et évita par là de se faire beaucoup d’affaires.
M. de Bertillac, croyant que son fils, qui étoit à l’armée, ne pouvoit pas manquer d’être averti de ce qui se passoit, se mit en tête qu’il valoit mieux que ce fût lui qui lui en donnât les premiers avis qu’un autre. Mais madame de Bertillac, qui avoit beaucoup de pouvoir sur l’esprit de son mari, l’ayant prévenu par une lettre, M. de Bertillac fut fort surpris qu’au lieu de remercîmens qu’il attendoit de son fils, il n’en reçût que des plaintes, comme si sa femme eût encore eu raison. Madame de Bertillac poussa l’artifice encore plus loin : elle manda à son mari de lui permettre de se retirer dans un couvent, disant qu’elle ne pouvoit plus vivre avec M. de Bertillac, qui en usoit avec elle d’une manière que s’il n’avoit pas été son beau-père, elle auroit cru qu’il auroit été amoureux d’elle, tant il étoit devenu jaloux.
Ces nouvelles fâchèrent son mari, qui l’aimoit tendrement, et qui étoit bien éloigné de la croire infidèle ; et, attribuant toute la faute à son père, le reste de la campagne lui dura mille ans, tant il étoit pressé d’aller consoler cette chère épouse. Cependant il manda à M. de Bertillac qu’il le prioit de laisser sa femme en repos ; qu’il connoissoit sa vertu, et que c’en étoit assez pour ne rien croire de tous les bruits qui couroient à son désavantage. Pour ce qui est d’elle, il lui écrivit de se donner bien de garde d’aller dans un couvent, à moins qu’elle ne le voulût faire mourir de douleur ; qu’elle prît patience jusqu’à la fin de la campagne, et qu’après cela il donneroit ordre à tout. En effet, il ne fut pas plus tôt revenu, qu’il ne voulut écouter personne à son préjudice. Ainsi il vécut avec elle comme à l’ordinaire, de sorte que si elle n’étoit point morte quelque temps après, elle auroit pris un si grand ascendant sur son esprit, qu’elle auroit fait tout ce qu’elle auroit voulu sans qu’il y eût jamais trouvé à redire.
La mort de madame de Bertillac [57] fit entrer la maréchale en elle-même. Elle dit à ses amis qu’elle vouloit renoncer à toutes les vanités du monde ; mais, comme elle en avoit dit autant à la mort du duc de Longueville, et que cependant elle n’en faisoit rien, on ne crut pas qu’elle tînt mieux parole cette fois-là que l’autre, en quoi l’on ne se trompa pas ; car la mort de son mari, qui arriva quelques années après [58], l’ayant mise en liberté de vivre à sa mode, elle fit succéder au Basque un nombre infini de fripons qui valoient encore moins que lui. Le chevalier au Liscouet [59] l’entretint jusqu’à ce qu’il en fût las, à qui succéda l’abbé de Lignerac [60] ; et comme elle lui faisoit part de son lit, elle l’obligea de lui faire part de sa bourse. Enfin l’abbé de Lignerac ayant quitté la belle-mère pour la belle fille, elle est réduite aujourd’hui à se livrer au petit du Pré [61], qui ne lui donne pas seulement de son Orviétan, mais qui lui apprend encore tous les tours de cartes et de souplesse avec lesquels ils dupent ensemble les nouveaux venus, et ceux qui sont assez fous de croire qu’on puisse jouer honnêtement chez une femme qui a renoncé depuis si longtemps à l’honnêteté [62].
L’exemple de la maréchale avoit excité la duchesse de La Ferté, sa belle-fille [63], à n’être pas plus vertueuse. Cependant, comme elle étoit plus jeune et qu’elle se croyoit plus belle, elle ne jugea pas à propos de se jeter à la tête de tout le monde, comme faisoit sa belle-mère. Présumant au contraire assez de sa beauté pour s’imaginer qu’elle pouvoit toucher le cœur du fils du grand Alcandre [64], elle commença non pas à lui faire la cour, mais à lui faire l’amour si ouvertement, que tout le monde ne put voir, sans en rougir pour elle, l’effronterie avec laquelle elle le poursuivoit.
La maréchale de La Motte [65], sa mère, qui avoit été gouvernante du fils du grand Alcandre, et qui avoit marié une autre de ses fille [66] au duc de Ventadour [67], de la conduite de laquelle elle n’étoit pas déjà trop contente, s’apercevant bientôt des desseins de celle-ci, résolut d’en arrêter le cours, pour conserver ce qui restoit de réputation à sa maison. Elle dit donc à la duchesse de La Ferté tout ce que l’expérience et l’autorité d’une mère lui pouvoient faire dire ; mais toutes ses remontrances ne servirent qu’à la faire cacher d’elle, pendant qu’elle exposoit aux yeux des autres des desseins qui faisoient murmurer les moins retenus ; car, un jour, ayant trouvé le fils du grand Alcandre d’assez bonne humeur, elle lui dit les choses du monde les plus hardies ; et ce prince ayant loué la beauté de ses cheveux, qui à la vérité sont fort beaux et d’une fort belle couleur, elle lui dit que s’il l’avoit vue décoiffée il les trouveroit encore bien plus à son gré ; que quand il voudroit, elle lui donneroit cette satisfaction ; et baissant en même temps la tête pour lui faire voir la quantité qu’elle en avoit, elle mit sa main dans un endroit que la bienséance m’empêche de nommer, pendant que le prince considéroit sa tête, sans penser peut-être à ce qu’elle faisoit.
Comme ce prince étoit beaucoup plus jeune qu’il n’est aujourd’hui, l’action de la duchesse de La Ferté lui fit plus de honte qu’à elle-même, et, se retirant en arrière, sa confusion augmenta quand il vit que sa chemise sortoit et qu’il la lui falloit raccommoder. La rougeur qui parut en même temps sur son visage, avec quelques autres circonstances qu’on remarqua, firent concevoir que la dame n’avoit pas perdu son temps pendant qu’elle s’étoit baissée ; mais, n’en paroissant pas plus étonnée pour cela, elle dit à ce prince, qui raccommodoit sa chemise, que cela n’étoit guère honnête de faire ce qu’il faisoit devant les dames, et que si son mari survenoit par hasard, cela seroit capable de lui donner de la jalousie.
Le prince ne lui donna pas lieu de poursuivre la conversation, dont la matière lui étoit désagréable ; tellement qu’après s’en être allé, elle fut dire à deux ou trois dames qui lui ressembloient qu’elle venoit de voir un homme qui n’étoit pas homme ; et, comme on ne savoit ce qu’elle vouloit dire par là et que cependant on vouloit le savoir, elle dit qu’elle venoit de voir le fils du grand Alcandre, qui ne seroit jamais le fils de son père. On la pressa d’expliquer cette énigme, ce qu’elle ne voulut pas faire, quoique ces dames l’en priassent. Mais elles n’eurent pas plus tôt su l’aventure qui étoit arrivée à ce jeune prince, que le reste leur fut aisé à deviner. Ainsi elles comprirent dans un moment que le désordre où il s’étoit trouvé étoit l’ouvrage des mains de la duchesse.
Le grand Alcandre, en ayant été averti, dit à la maréchale de La Motte qu’il n’étoit point content du tout de sa fille ; qu’elle l’avertît d’avoir une conduite plus honnête, sinon qu’il seroit obligé d’en dire un mot à son mari [68]. Cependant, ce mari étoit un homme qui ne se mettoit guère en peine ni de la réputation de sa femme, ni de la sienne propre, et, pourvu qu’il bût et qu’il allât chez les courtisanes, il étoit au-dessus de tout ce que l’on pouvoit dire et de tout ce qui pouvoit arriver. Il étoit toujours avec un tas de jeunes débauchés comme lui, et tous leurs beaux faits n’étoient que de pousser la débauche jusqu’à la dernière extrémité, tellement que les filles de joie, tout aguerries qu’elles devoient être, ne les voyoient point entrer chez elles sans trembler.
Ils firent en ce temps-là une débauche qui alla un peu trop loin et qui fit beaucoup de bruit et à la cour et dans la ville : car, après avoir passé toute la journée chez des courtisanes où ils avoient fait mille désordres, ils furent souper aux Cuilliers, dans la rue aux Ours [69]. Ils se prirent là de vin, et, étant soûls pour ainsi dire comme des cochons, ils firent monter un oublieur, à qui ils coupèrent les parties viriles et les lui mirent dans son corbillon. Ce pauvre malheureux, se voyant entre les mains de ces satellites, alarma non-seulement toute la maison, mais encore toute la rue par ses cris et ses lamentations ; mais quoiqu’il survînt beaucoup de monde qui les vouloient détourner d’un coup si inhumain, ils n’en voulurent rien démordre, et, l’opération étant faite, ils renvoyèrent le malheureux oublieur, qui s’en alla mourir chez son maître.
Cet excès de débauche, ou plutôt cet excès de rage, ayant été su du grand Alcandre, il en fut en une colère épouvantable. Mais la plupart de ces désespérés appartenant aux premiers de la cour et aux ministres, il jugea à propos, à la considération de leurs parens, de se contenter de les éloigner. Les parens trouvèrent cet arrêt si doux, en comparaison de ce qu’ils méritoient, qu’ils en furent remercier le grand Alcandre, avouant de bonne foi qu’un crime si énorme ne méritoit pas moins que la mort.
Le marquis de Biran [70] et le chevalier Colbert [71], qui étoient de la débauche et toujours des premiers à mettre les autres en train, furent un peu mortifiés avant que de partir : car celui-ci, qui étoit fils du fameux M. Colbert, en fut régalé d’une volée de coups de bâton qu’il lui donna en présence du monde, parce que, comme il étoit grand politique, il étoit bien aise qu’on fût dire au grand Alcandre qu’il n’avoit pu savoir un tel déréglement sans qu’il fût suivi d’un châtiment proportionné à la faute. A l’égard du marquis de Biran, le grand Alcandre dit, en parlant de lui, qu’il n’avoit que faire de prétendre de sa vie de devenir duc, et qu’il seroit toujours plus prêt à lui donner des marques de son mépris qu’à faire aucune chose qui tendît à sa fortune. Cependant nous venons de voir, il n’y a guère, que ce prince ne s’est pas ressouvenu de sa parole, à moins qu’on ne veuille dire que ce n’est pas au marquis de Biran qu’il vient d’accorder le rang de duc, mais à mademoiselle de Laval [72], qu’il a épousée.
Le bruit qu’avoit fait cette débauche étant un peu apaisé, les parens des exilés sollicitèrent leur retour, pendant que la duchesse de La Ferté souhaitoit que son mari ne revînt pas si tôt, par des raisons fortes et que je rapporterai succinctement. Comme elle avoit reconnu que c’étoit inutilement qu’elle avoit prétendu à la conquête du fils du grand Alcandre, elle s’étoit rabattue sur le premier venu, dont elle n’avoit point lieu du tout d’être contente. Quelqu’un lui avoit fait un fort méchant présent, et comme elle ne connoissoit rien à un certain mal qui l’incommodoit, elle prit le parti d’aller incognito chez un fameux chirurgien pour en être éclaircie. Y étant arrivée toute seule avec une chaise à porteurs, ce qui ne faisoit rien présumer de bon d’une femme de son air, elle lui exposa son affaire sans façon, lui disant qu’elle ressentoit depuis quelques jours quelques incommodités qui lui faisoient craindre que son mari, qui étoit un peu débauché, n’eût pas eu toute la considération qu’il étoit obligé d’avoir pour elle ; qu’elle le prioit d’examiner la chose et de lui en dire son sentiment. Et faisant en même temps exhibition de ses pièces, elle s’attendoit que le chirurgien alloit du moins se montrer pitoyable [73] en entrant dans ses intérêts ; mais celui-ci, étant accoutumé tous les jours à entendre rejeter sur les pauvres maris des choses dont ils sont le plus souvent innocens, il lui dit qu’il étoit tant rebattu de ces sortes de contes, qu’il ne pouvoit plus avoir de complaisance pour celles qui les lui faisoient ; que sans se mettre davantage en peine d’accuser son mari, elle songeât seulement à se faire traiter promptement, parce que le mal qu’elle avoit pouvoit devenir pire, si par hasard elle venoit à le négliger.
Cet arrêt étonna la duchesse, qui avoit ouï parler plusieurs fois à son mari de ces sortes de maux, dans lesquels l’expérience le rendoit savant. Ainsi, étant bien aise de savoir si celui qu’elle avoit étoit le plus grand de tous, elle s’en informa du chirurgien. Le chirurgien lui dit que non, mais que, comme il lui avoit déjà dit, il falloit y remédier promptement, sinon qu’il pouvoit le devenir. Comme elle eut entendu cela, elle lui dit qu’elle avoit tant de confiance en lui, sur la réputation qu’il avoit dans le monde, qu’elle s’abandonnoit entièrement entre ses mains ; et se nommant en même temps, elle surprit le chirurgien, qui, sachant qu’il avoit affaire à une personne de la première qualité, fut fâché de lui avoir parlé si nettement. Il lui demanda pardon de ce qu’il s’étoit montré si libre en paroles, s’excusant que comme les plus abandonnées lui tenoient le même langage qu’elle lui avoit tenu, il avoit cru être obligé de lui répondre ce qu’il avoit fait, n’ayant pas l’honneur de la connoître.
La duchesse lui pardonna aisément, à condition néanmoins qu’il la sortiroit [74] bientôt d’affaire ; ce que le chirurgien lui promit si elle vouloit observer un certain régime de vivre. Elle lui dit qu’elle feroit tout ce qu’il lui ordonneroit, et même fit encore davantage : car elle voulut garder le lit tant qu’elle fut dans les remèdes, craignant que si elle continuoit de vivre comme elle avoit de coutume, les veilles n’échauffassent son sang et ne rendissent la guérison plus difficile.
Cependant, quoiqu’elle ne voulût voir personne, comme elle se seroit beaucoup ennuyée d’être toute seule, elle permit à M. L’Avocat [75], maître des requêtes, qui lui disoit depuis longtemps qu’il l’aimoit sans en pouvoir tirer aucunes faveurs, de la venir voir. L’Avocat étoit fils d’un juif de la ville de Paris, qui, après avoir gagné deux millions de bien par ses usures, s’étoit laissé mourir de froid, de peur de donner de l’argent pour avoir un fagot. Sa mère étoit encore de race juive ; cependant, comme s’il n’eût pas été connu de tout Paris, il faisoit l’homme de qualité. On lui avoit mis une charge de robe sur le corps, comme on fait une selle à un cheval ; mais il étoit si peu capable de s’en acquitter, que tout le monde se moquoit de lui. Cela faisoit qu’il ne se plaisoit qu’avec les gens d’épée, à qui il servoit de divertissement. Il affectoit de paroître chasseur, quoiqu’il ne sût aucuns termes de l’art ; et quand il lui arrivoit de tirer un coup de fusil, ce qui ne lui arrivoit pas souvent, il tournoit la tête en arrière, de peur que le feu ne prît à ses cheveux ; au reste, grand parleur et grand menteur, mais avec tout cela le meilleur homme du monde, offrant service à un chacun sans jamais en rendre à personne.
La réputation où il étoit de n’être pas trop dangereux avec les femmes, à qui l’on disoit même qu’il ne pouvoit faire ni bien ni mal, ayant fait croire à la duchesse de La Ferté qu’il s’apercevroit moins qu’un autre du sujet qui la retenoit au lit, elle lui manda de la venir voir, et, lui faisant valoir cette grâce, elle en reçut des remerciemens proportionnés à son esprit. Il lui protesta qu’après des marques d’une si grande distinction il vouloit vivre et mourir son serviteur très humble ; et pour lui donner des témoignages plus essentiels de son attachement, il lui jura qu’elle et ses amis n’auroient jamais de procès par-devant lui qu’il ne le leur fît gagner, sans entrer en connoissance de cause qui auroit raison ou non ; que c’étoit ainsi que les bons amis en devoient agir, sans rien examiner davantage que le plaisir de leur rendre service.
Après mille autres protestations de service de la même sorte, il en revint enfin à l’amour qu’il avoit pour elle depuis si longtemps ; et, tâchant d’accorder ses yeux avec ses paroles, il les tourna languissamment sur elle, lui demandant si elle étoit résolue de le faire mourir. La duchesse lui dit qu’apparemment ce n’étoit pas là son dessein, ce qu’il pouvoit bien juger lui-même, puisqu’elle l’avoit envoyé quérir, se ressouvenant qu’il lui avoit dit plusieurs fois qu’il ne pouvoit vivre sans la voir. Cette réponse fit que L’Avocat recommença ses complimens, qui n’auroient point eu de fin si elle ne les eût interrompus pour lui demander comment il gouvernoit Louison d’Arquien [76]. Il rougit à cette demande, et la duchesse, s’en étant aperçue, lui dit qu’elle estimoit les hommes qui avoient de la pudeur ; qu’il étoit bien vrai que, cette fille étant une courtisane publique, il n’y avoit pas trop d’honneur à la voir ; mais que le comte de Saulx, le marquis de Biran, le duc de La Ferté même, et enfin toute la cour la voyant, il n’y avoit pas plus d’inconvénient pour lui à la voir qu’à tant de personnes de qualité ; que pourvu qu’il ne l’entretînt pas publiquement, comme le bruit en couroit, il n’y avoit pas grand mal ; mais que pour elle, elle n’en avoit jamais voulu rien croire, l’ayant toujours reconnu trop sage et trop homme d’honneur pour cela.
M. L’Avocat, maître des requêtes, soutint hautement que c’étoit une médisance, et même il auroit encore soutenu qu’il ne l’avoit jamais vue, si la duchesse, qui le voyoit embarrassé, ne lui eût donné moyen de s’excuser, tournant la conversation comme elle avoit fait. Il lui dit donc qu’il n’y avoit jamais été que par compagnie, et, croyant dire les plus belles choses du monde, il lui jura que, quelque beauté qu’eussent ces sortes de femmes-là, il faisoit bien de la différence entre elles et une personne de son mérite ; et tâchant de faire son portrait en même temps, il lui fit voir qu’il avoit beaucoup de mémoire, s’il n’avoit pas beaucoup de jugement, car la duchesse se ressouvint d’avoir lu, il y avoit quelques jours, dans un livre de galanterie, toutes les choses dont il lui faisoit alors l’application.
Cependant elle fut toute prête de se scandaliser de la comparaison qu’il sembloit avoir faite d’elle et de Louison d’Arquien : car, quelque distinction qu’il y eût apportée, elle ne laissoit pas de la choquer, et cela apparemment parce que, sachant elle-même la vie qu’elle menoit, elle croyoit que c’étoit un avertissement secret que L’Avocat lui donnoit de se corriger. Cependant, comme elle fit réflexion qu’il n’étoit pas malicieux de son naturel, et que cette parole lui étoit échappée plutôt par hasard qu’à aucun méchant dessein, elle calma sa colère, en sorte que la conversation se termina sans aigreur.
Le lendemain il la revint voir, et trouva la duchesse fort mal, car elle avoit pris ce jour-là un grand remède. Elle se plaignit fort d’une grande douleur qu’elle souffroit, et, l’attribuant à une médecine qu’elle avoit prise, dont il restoit encore environ la moitié dans un verre, il fut prendre ce verre et avala ce qui étoit dedans. Il dit, avant que de le faire, qu’il ne vouloit pas qu’il fût dit que la personne du monde qu’il aimoit le plus souffrit pendant qu’il étoit en santé.
La duchesse ne put s’empêcher de rire de cette extravagance, qu’il faisoit cependant sonner bien haut comme une marque de la plus belle amitié qui fut jamais. Mais, faisant réflexion ensuite que cette médecine l’empêcheroit peut-être de sortir le lendemain, et qu’il ne pourroit par conséquent voir la duchesse ce jour-là, il poussa des regrets et des soupirs qui l’auroient fait crever de rire nonobstant la douleur qu’elle ressentoit, si elle eût osé témoigner sa pensée. Ce fut par là que se termina cette comédie ; car des tranchées l’ayant pris en même temps, à peine eut-il le temps de gagner son carrosse et de se retirer chez lui.
Comme il y avoit du mercure dans la médecine, il fut tourmenté comme il faut toute la nuit et tout le lendemain ; et, ne pouvant aller chez la duchesse, il lui écrivit un billet dont je ne puis pas rapporter les paroles, n’étant jamais tombé entre mes mains, mais dont ayant assez ouï parler dans le monde, comme d’une chose ridicule, j’en puis dire le sens, que voici : « Qu’il ne pouvoit avoir l’honneur de la voir de tout le jour, parce qu’il étoit devenu comme ces filles de joie, lesquelles ne peuvent plus répondre de ne point faire de folies de leur corps, tant elles y sont accoutumées ; que le sien étoit tellement habitué à de certaines choses qu’il n’osoit dire, qu’il falloit qu’il gardât la chambre jusqu’à ce qu’il fût entièrement remis de son indisposition ; qu’il la prioit cependant d’être persuadée qu’il n’avoit pas pris la médecine comme un remède contre l’amour, mais pour lui montrer qu’il seroit amoureux d’elle toute la vie. »
La duchesse lut et relut ce billet, s’étonnant comment un homme qui avoit cinquante ans passés, et qui avoit vu le monde, pouvoit être si fou, et, étant bien aise de continuer à s’en divertir, elle eut de l’impatience de le revoir et qu’il fût quitté de la sottise. L’Avocat, après avoir souffert deux jours tout ce qu’on peut souffrir dans ces sortes de remèdes, lui vint dire qu’enfin il étoit quitte, grâce à Dieu, du mal qu’il avoit enduré ; qu’il lui souhaitoit une santé pareille à celle dont il jouissoit, et que s’il savoit qu’en faisant encore ce qu’il avoit fait il dût avancer sa guérison, il étoit prêt de se dévouer à toutes sortes de tourmens pour l’amour d’elle.
La duchesse le remercia de sa bonne volonté, et lui dit que, commençant à se porter mieux, il y avoit espérance que son mal ne seroit plus guère de chose ; que cependant, à mesure que le corps se guérissoit, l’esprit devenoit malade ; qu’elle avoit besoin de deux cents pistoles pour une affaire pressée, et, ne sachant où les trouver, elle n’avoit aucun repos ni jour ni nuit.
Quoique L’Avocat fût fils, comme j’ai dit ci-devant, d’un homme riche, trois choses contribuoient néanmoins à le rendre peu à son aise : la première, que son père avoit laissé beaucoup d’enfans ; la seconde, que sa mère juive, qui avoit emporté la moitié du bien, vivoit toujours ; la troisième, qu’il avoit une charge qui lui avoit coûté beaucoup, et qui ne lui rapportoit pas grand revenu. Tout cela faisant, dis-je, qu’il étoit brouillé le plus souvent avec l’argent comptant, il ne put offrir à l’heure même les deux cents pistoles dont elle avoit affaire ; il lui promit qu’il les lui apporteroit le lendemain, et en effet il ne manqua pas à sa parole, ce qui étoit une chose bien extraordinaire pour lui.
Je ne puis pas dire quel besoin la duchesse avoit de cet argent, cela étant au-dessus de ma connoissance ; mais s’il m’est permis d’en juger par les circonstances qui suivirent, je dirai qu’il falloit qu’il fût grand, car, voyant L’Avocat arriver avec une bourse, elle l’embrassa, non pas tendrement, mais avec des apparences du moins d’une grande tendresse. L’Avocat en étant excité à des choses qui surpassoient, ce me semble, ses forces naturelles, il chercha à ne pas laisser échapper une occasion qui ne se présentoit pas tous les jours chez lui, et à laquelle la duchesse ne faisoit aucune résistance.
Enfin, soit que la duchesse ne se souvînt plus du régime de vivre que le chirurgien lui avoit ordonné, ou qu’elle s’imaginât d’avoir quelqu’un entre ses bras de plus agréable que L’Avocat, elle ne voulut pas avoir quelque chose pour rien, et lui donna des faveurs au lieu de son argent. Comme L’Avocat n’étoit pas importun sur l’article, il se contenta de ce témoignage d’amour de la duchesse, sans lui en demander d’autres. Après cela il se retira chez lui le plus content du monde ; et, ne s’entretenant que des grandeurs où il étoit appelé, il en devint encore plus fou et encore plus vain qu’à l’ordinaire.
Cependant, comme il avoit soin de sa santé et qu’il avoit ouï dire que l’excès en toutes choses est nuisible, il fut trois ou quatre jours sans retourner chez la duchesse, au bout desquels il commença à s’apercevoir qu’on tomboit malade souvent lorsqu’on en avoit le moins d’envie. Il eut peine à croire d’abord ce qu’il voyoit ; mais enfin, sachant que les plus incrédules avoient cru quand ils avoient vu, il commença à se laisser persuader qu’il en pouvoit bien être quelque chose, surtout quand, après une consultation où il avoit appelé Janot et deux autres chirurgiens de même trempe, ils lui dirent qu’il avoit besoin de passer par leurs mains. Ce fut un étrange retour pour un homme enflé de vanité comme lui. Cependant, il ne put dire, dans un tel accident, à quoi il étoit le plus sensible, ou au dépit ou à la joie : car si d’un côté il lui sembloit que la duchesse en avoit mal usé en le ménageant si peu pour la première fois, d’un autre côté il considéroit que c’étoit toujours un présent d’une duchesse ; et comme la vanité avoit beaucoup de pouvoir sur lui, il se disoit en même temps que les faveurs de telles personnes, quelles qu’elles fussent, étoient toujours considérables. Une autre réflexion se joignit encore à celle-ci : savoir que, cet accident étant répandu dans le monde, il alloit rétablir sa renommée chez toutes les femmes, qui, l’ayant pris jusque-là pour un parent du marquis de Langey [77], c’est-à-dire pour un homme qu’il auroit fallu démarier, s’il avoit eu une femme, elles seroient obligées d’avouer qu’on se trompe souvent dans le jugement que l’on fait de son prochain.
Aussi étoit-ce pour cette raison-là qu’il avoit entretenu Louison d’Arquien si publiquement, comme lui avoit reproché la duchesse, ainsi que j’ai rapporté ci-dessus. Mais on n’avoit pas eu meilleure opinion pour cela de sa bravoure, et il fallut cette dernière circonstance pour détromper tout le monde. Au lieu donc de se cacher, comme un autre auroit fait, il se mit dans les remèdes publiquement, et, ses bons amis se doutant de son incommodité, il les confirma dans leurs soupçons, et en fit galanterie comme un jeune homme auroit pu faire.
Cependant cette circonstance, qu’il croyoit si avantageuse à sa réputation, fut plus nuisible à sa fortune qu’il ne pensoit : car, outre que pour avoir été mal pansé dans les commencemens, ou peut-être pour être d’un tempérament difficile à guérir, il fut obligé d’entrer dans le grand remède, le grand Alcandre, ayant su son désordre, perdit le peu d’estime qu’il pouvoit avoir pour lui, et lui refusa la charge de prévôt des marchands de la ville de Paris, qu’il étoit disposé de lui accorder, à la recommandation de M. de Pomponne [78], son beau-frère, qui étoit l’un de ses ministres.
L’aventure de M. L’Avocat, que tout le monde ne manqua pas d’imputer à la duchesse de La Ferté, donna un grand chagrin à la maréchale de la Motte, sa mère, qui d’ailleurs n’étoit guère plus contente de la duchesse de Ventadour, qui accusoit son mari de lui avoir fait présent d’une galanterie, mais qui, sous prétexte qu’il étoit débauché, s’en donnoit à cœur joie avec M. de Tilladet [79], cousin germain du marquis de Louvois. Le duc de Ventadour étoit un petit homme tout contrefait, mais qui ne manquoit pas de courage, tellement qu’ayant eu quelque vent de l’intrigue de sa femme, il résolut de l’observer si bien qu’il pût la prendre sur le fait. Pour cet effet, il lui permit de faire un voyage avec la duchesse d’Aumont, sa sœur [80], se doutant bien qu’en cas qu’il en fût quelque chose, le galant ne manqueroit pas de se rencontrer en chemin. Cependant il monta à cheval pour voltiger sur les ailes, et il arrivoit tous les soirs incognito à la même hôtellerie où sa femme logeoit. Il n’eut pas fait ce manége cinq ou six jours, qu’il vit arriver en poste M. de Tilladet, qui fut si pressé de voir madame de Ventadour, qu’il ne se donna pas le temps de se faire débotter, ni même de se donner un coup de peigne. Il fit semblant devant le duc d’Aumont [81], qui étoit aussi du voyage, que le hasard l’avoit conduit dans l’hôtellerie ; mais le duc de Ventadour, qui savoit bien ce qu’il en devoit penser, ne lui donnant pas le temps d’entrer en conversation, il monta en haut en même temps, et, mettant l’épée à la main, il surprit toute la compagnie, qui ne songeoit guère à lui, et qui le croyoit bien éloigné de là.
Le duc d’Aumont, qui avoit épousé en premières noces la sœur de M. de Louvois, cousine germaine de M. de Tilladet, prit son parti contre le duc de Ventadour son beau-frère, prenant pour prétexte que, comme il avoit si peu de considération pour lui que de venir attaquer jusque dans sa chambre un homme qui ne lui avoit jamais donné sujet d’être son ennemi, il ne méritoit pas qu’il fît nulle réflexion sur leur proximité. Ainsi, avec l’aide de ses gens, il empêcha qu’il n’arrivât du désordre, et, ayant reconnu qu’il y avoit de la jalousie sur le jeu, il conseilla à la duchesse de Ventadour de se donner bien de garde de s’en aller avec son mari, qui la vouloit emmener à toute force ; à quoi elle obéit ponctuellement.
Ce refus de madame de Ventadour outra entièrement son mari, et, comme il étoit beaucoup mutin, il défia le duc d’Aumont au combat, à qui il dit des choses tout à fait outrageantes ; mais à quoi il crut ne devoir pas prendre garde, parce qu’elles partoient d’un homme qui n’étoit pas en grande estime dans le monde.
Cependant, le duc de Ventadour ayant été obligé de partir sans sa femme, il fut se plaindre au grand Alcandre du procédé du duc d’Aumont ; et les plus grands de la cour ayant pris parti dans cette querelle, le prince de Condé [82], qui étoit proche parent du duc de Ventadour, dit des choses fâcheuses à la maréchale de La Motte, qui, prétendant excuser sa fille et le duc d’Aumont, tâchoit de déshonorer le duc de Ventadour. Le grand Alcandre défendit les voies de fait de part et d’autre, et, ayant pris connoissance de l’affaire, il donna le tort au duc, et permit à sa femme de retourner avec lui ou de se retirer en religion, selon que bon lui semblerait.
Ces deux partis n’accommodoient guère la duchesse, qui en eût bien mieux aimé un troisième s’il eût été à son choix, qui étoit de demeurer avec la duchesse d’Aumont, sa sœur, où elle eût pu voir tous les jours M. de Tilladet ; mais le grand Alcandre ayant prononcé, ce fut à elle à se soumettre à son jugement, ce qu’elle fit en se retirant à un petit couvent au faubourg Saint-Marceau [83]. M. de Tilladet la vit là deux ou trois fois incognito, du consentement de la supérieure.
Peu de temps après, les exilés dont j’ai parlé tantôt revinrent à la cour, et ils furent obligés de se montrer plus sages. Le duc de La Ferté trouva sa femme guérie, mais L’Avocat ne l’étoit pas ; et quoi qu’il se fût consolé d’abord, dans l’espérance, comme j’ai dit, d’être après cela en meilleure réputation dans le monde, il lui en coûta si cher, qu’il auroit renoncé de bon cœur à toutes les vanités du monde et être sorti du bourbier où il étoit. Enfin son chirurgien l’ayant tiré d’affaire, il ne se souvint plus du mal qu’il avoit eu ; et comme il avoit ouï parler de l’affaire du duc d’Aumont et du duc de Ventadour, et que son sort étoit de s’entremettre pour les accommodemens, comme je dirai ci-après, il dit à l’un et à l’autre qu’il étoit bien fâché de n’avoir pas été en bonne santé dans ce temps-là, et qu’il auroit tâché de leur rendre service.
Cependant, comme il avoit la couleur d’un véritable mort, chacun demanda s’il revenoit de l’autre monde ; à quoi il fut fort embarrassé de répondre. Mais s’étant à la fin aguerri à toutes ces demandes, il fut le premier à en rire avec les autres, ce qui fit cesser toutes les railleries qu’on lui en faisoit. Cependant, la duchesse de La Ferté lui en ayant un jour voulu faire la guerre, comme naturellement il est fort brutal : « Morb…, Madame, lui répondit-il, cela est bien de mauvaise grâce à vous, qui après m’avoir mis vous-même dans l’état où je suis, devriez du moins avoir l’honnêteté de me ménager. Croyez-moi, ce sera pour la première et pour la dernière fois de ma vie que j’aurai affaire à vous ; et quoique j’aie vu Louison d’Arquien un an tout entier, ce que je veux bien vous avouer maintenant, je n’ai jamais eu le moindre sujet de m’en repentir toute ma vie. »
La duchesse de La Ferté ne put souffrir ses reproches sans entrer dans un emportement épouvantable. Elle prit les pincettes du feu, dont elle lui déchargea un coup de toute sa force, et, faisant succéder les injures aux coups, elle lui dit que c’étoit bien à faire à un petit bourgeois comme lui, de vouloir familiariser avec une femme de sa qualité ; que quand ce qu’il disoit seroit vrai, elle lui avoit fait encore trop d’honneur ; qu’il prît la peine de sortir de sa maison, sinon qu’elle l’en feroit sortir par les fenêtres ; et, le poussant dehors avec le bout des pincettes, L’Avocat, qui voyoit qu’il n’y avoit point de raillerie avec elle, se jeta à ses pieds, la priant de lui vouloir pardonner ; qu’il connoissoit bien qu’il avoit tort, mais qu’il lui étoit dur de voir qu’elle l’insultoit, s’imaginant que ce qu’elle en faisoit n’étoit que par mépris ; que c’étoit là le sujet de ses plaintes ; qu’elle entrât dans ses sentimens, qu’il n’y avoit rien à redire à sa délicatesse ; et que, si elle avoit été présente à ses tourmens, elle auroit vu qu’il les avoit soufferts avec tant de résignation, qu’elle avoueroit qu’il étoit un véritable martyr d’amour.
Toutes ces raisons n’adoucirent point l’esprit de la duchesse, qui étoit hautaine et méprisante ; et, l’ayant fait sortir de sa chambre, elle lui défendit de la revenir voir jamais, s’il ne vouloit s’exposer à un traitement beaucoup plus rude. L’Avocat s’en alla le cœur gros ; poussant des soupirs et ayant enfin toutes les envies du monde de pleurer ; mais comme il avoit à passer la cour de l’hôtel de La Ferté, qui est fort grande, et qu’il craignoit là de rencontrer quelqu’un, il retînt ses larmes jusqu’à ce qu’il fût dans son carrosse.
Comme il y montoit, il vint un des gens du maréchal de La Ferté lui dire que son maître vouloit lui parler avant qu’il s’en allât ; ce qui fut cause qu’il tâcha encore de les retenir. Et après avoir raccommodé sa perruque et son rabat, qui étoient un peu en désordre, il monta dans l’appartement du maréchal, où il trouva une dame fort bien faite avec quelques gentilshommes, qui étoient là les uns et les autres pour une querelle qu’ils avoient ensemble. Le maréchal lui dit qu’il lui avoit donné la peine de monter pour voir s’il n’y auroit point moyen de les accommoder sans les obliger de venir à une assemblée générale des maréchaux de France [84] ; et que comme il y avoit eu quelques procédures de faites de part et d’autre, et que cela le regardoit (car le grand Alcandre lui avoit attribué la connoissance de ces sortes de choses), il étoit bien aise qu’il lui en dît son sentiment.
L’Avocat lui demanda de quoi il s’agissoit, et, le maréchal lui ayant dit qu’il avoit dû voir les informations, le maître des requêtes lui répondit que son secrétaire ne les lui avoit pas encore données ; ce qui lui servit d’excuse légitime, le maréchal sachant que c’étoit un usage établi chez lui que de laisser tout faire à son secrétaire. Il lui dit donc que la dame qu’il voyoit là devant lui se plaignoit qu’un gentilhomme, qui étoit aussi là présent, l’avoit déshonorée par des contes scandaleux, et dont elle demandoit réparation ; que quoiqu’il n’y eût point de témoins, la chose étoit néanmoins avérée par le propre aveu du gentilhomme, qui soutenoit que, bien loin d’avoir eu tort de parler mal de cette dame, il en avoit eu fort grande raison ; que, pour justifier cela, il rapportoit qu’il l’avoit aimée passionnément, avoit recherché toutes les occasions de lui rendre service, lui en avoit rendu même d’assez considérables, jusqu’à lui avoir prêté pour une seule fois deux cents pistoles ; mais que, pour toute récompense, elle ne lui avoit donné qu’une maladie qui l’avoit tenu trois mois entiers sur la litière, dont croyant avoir lieu de se plaindre, il avoit publié que cette dame n’étoit pas cruelle, mais que cependant il ne vouloit plus de ses faveurs à ce prix-là.
L’Avocat, entendant une histoire qui avoit tant de rapport avec la sienne, crut que son intrigue étoit découverte, et qu’il falloit que quelqu’un eût écouté au travers de la porte de la duchesse de La Ferté. C’est pourquoi, perdant toute sorte de contenance, il rougit, il pâlit, et, mettant son manteau sur son nez, il dit au maréchal qu’il se mocquoit de lui, et prit le chemin de la porte sans lui rien dire davantage. Le maréchal, qui étoit dans son lit, rongé de ses gouttes, ne pouvant courir après lui, le rappela ; mais, voyant qu’il ne vouloit point revenir, il dit à son capitaine des gardes de ne le pas laisser aller comme cela et qu’il avoit besoin de lui pour accommoder cette affaire. L’Avocat fit difficulté de revenir, disant au capitaine des gardes que monsieur le maréchal se railloit de lui ; mais le capitaine des gardes lui ayant dit qu’il n’y avoit point de raillerie à cela, et que ce qu’il en faisoit n’étoit que parce qu’il eût été bien aise de rendre service à ces personnes-là, il rentra dans la chambre, et le maréchal lui demanda depuis quand il ne vouloit plus accommoder les gentilshommes : reproche qu’il lui faisoit parce qu’il savoit que, sous prétexte de cette occupation, il négligeoit les autres affaires qui étoient du dû de sa charge de maître des requêtes.
Après que L’Avocat se fut excusé le mieux qu’il put, on parla de l’affaire en question, et, sans attendre qu’on en déduisît tout au long les particularités, il conclut que le gentilhomme seroit envoyé en prison, d’où il ne sortiroit qu’après avoir demandé pardon à la dame, qui, pour le remercier de ses conclusions favorables, lui fit une grande révérence. Comme c’étoit là l’avis du maréchal, ce qu’il avoit dit fut suivi de point en point, de sorte que le gentilhomme fut envoyé en prison. Cependant, monsieur L’Avocat s’étant retiré chez lui, se fit donner de l’encre et du papier, et écrivit à la duchesse de La Ferté un billet dont voici la copie :
Billet de M. L’Avocat à la duchesse de La Ferté.
Je ne vous pouvois faire une plus grande réparation de ma faute que celle que je vous ai faite en sortant de votre chambre : Un gentilhomme, qui avoit avec une dame une pareille affaire que celle que j’ai avec vous, a été envoyé en prison, et je l’ai condamné, outre cela, à se rétracter de tout ce qu’il avoit dit, quoiqu’il n’eût peut-être dit que la vérité, comme je puis avoir fait. Si une semblable réparation vous peut satisfaire, ordonnez-moi seulement dans quelle prison vous voulez que j’aille, et j’y obéirai ponctuellement, ayant résolu d’être toute ma vie votre fidèle prisonnier d’amour.
La duchesse de La Ferté reconnut le caractère de L’Avocat à ce billet, qui étoit de dire des sottises lorsqu’il croyoit dire les plus belles choses du monde. Elle fut tentée mille fois de lui faire une réponse fort aigre ; mais jugeant que cela tiendroit plus du ressentiment que du mépris, elle demeura dans le silence. Cela affligea extrêmement L’Avocat, qui, outre le plaisir qu’il se faisoit d’être bien avec une duchesse, se voyoit privé par là d’aller dîner chez elle, ce qui lui étoit fort commode et ce qui lui arrivoit souvent, ne faisant point d’ordinaire [85] et la duchesse logeant fort près de chez lui. Comme il vit enfin que sa disgrâce duroit toujours, il s’adonna entièrement chez le duc de Ventadour, à qui il conseilla de se raccommoder avec sa femme. Il fut l’entremetteur secret de ce raccommodement, et, trouvant là ce qu’il avoit perdu, c’est-à-dire autant de qualités tout au moins que chez la duchesse de La Ferté, une belle femme et une bonne table, il piqua la table assidument, et tâcha de se mettre bien auprès de la femme, qui, étant plus réservée que sa sœur dans ses plaisirs, le rebuta tellement la première fois qu’il lui voulut parler, qu’il n’osa plus s’exposer à un second refus.
Cependant, le duc et la duchesse de La Ferté continuoient toujours de vivre comme ils avoient commencé. La duchesse avoit l’abbé de Lignerac pour tenant, et son argent lui tenoit lieu de mérite. Pour ce qui est du duc, il ne s’arrêtoit nulle part, et comme il n’étoit pas homme à filer le parfait amour, il trouvoit toutesfois et quantes qu’il en vouloit des maîtresses dans les lieux publics. Sa passion étant là bien assouvie, il les battoit le plus souvent après les avoir caressées et faisoit ainsi succéder les caresses aux coups. Un jour qu’il faisoit la débauche dans un de ces endroits-là avec le duc de Foix, Biran et quelques autres, Biran lui dit qu’il s’étonnoit de ce que lui, qui aimoit à goûter les plaisirs dans leur naturel, n’eût pas fait venir coucher sa femme une fois chez Louison d’Arquien, ou chez Madelon du Pré ; qu’il y auroit trouvé mille fois plus de satisfaction que chez lui, et que, s’il en vouloit essayer, il lui en diroit après son sentiment.
Quoique le duc de La Ferté ne fût pas trop délicat sur le chapitre de sa femme, il trouva à redire que Biran lui parlât de la faire venir dans un lieu de débauche, et le duc de Foix, qui étoit beau-frère de Biran, fut le premier à le condamner, ajoutant que la duchesse de La Ferté n’étoit pas femme à venir dans ces sortes de lieux-là. Biran lui répondit qu’elle étoit personne à y venir tout comme une autre, et même sa femme [86], qui faisoit plus la scrupuleuse que la duchesse de La Ferté ; que, s’ils vouloient parier seulement cent pistoles contre lui, que lui qui parloit, les y feroit venir quand il voudroit. Et s’étant mis à assurer la chose, il fit rire toute la compagnie, qui le connoissoit pour un homme infiniment agréable et qui avoit beaucoup d’esprit. Il ne se rétracta pas cependant de ce qu’il avoit avancé, mais, formant en même temps la résolution de leur faire voir l’effet de ce qu’il leur disoit, il changea de discours adroitement, si bien qu’on ne fit plus de réflexion à ce qu’il avoit dit.
À cinq ou six jours de là, Biran fut voir sa sœur la duchesse de Foix [87], et lui dit qu’il avoit fait une partie avec la duchesse de La Ferté pour aller à la foire S.-Germain [88], et que si elle en vouloit être, il les y mèneroit toutes deux un matin, mais qu’il n’en falloit rien dire à son mari ; que la duchesse de La Ferté n’en diroit rien pareillement au sien, et qu’il y avoit des raisons pour cela, qu’il ne lui apprendroit que quand ils seroient à la foire. La duchesse de Foix, sans s’informer autrement de ces raisons-là, accepta la partie, et le jour étant pris pour le lendemain, il la fut prendre dans son carrosse, et fut quérir de là la duchesse de La Ferté, à qui il en dit autant.
Comme ils furent en chemin, quelque chose manqua tout d’un coup au carrosse, et ces deux dames, ayant peur de verser, crièrent au cocher d’arrêter, qui leur obéit aussitôt, tout cela n’étant qu’une pièce faite à la main par Biran, afin de montrer à leurs maris qu’il ne leur avoit rien dit qu’il ne fût sûr d’exécuter. Cependant, ayant donné la main à ces dames, il fît fort de l’empressé, demanda à son cocher ce que c’étoit, et le querella beaucoup en apparence de ce qu’il n’avoit pas fait accommoder son carrosse devant que de sortir. Il dit cependant à ces dames qu’il n’y avoit point d’apparence de demeurer dans la rue ; qu’il connoissoit une bourgeoise tout auprès de là ; qu’il falloit monter chez elle et se reposer, en attendant que le carrosse fût raccommodé.
Ces dames n’ayant point d’autre parti à prendre que celui-là, elles s’y accordèrent volontiers, et étant montées dans une maison, elles y furent reçues par une femme qui leur fit beaucoup de civilités. Cette femme les fit entrer dans une chambre fort propre, où elle les entretint assez spirituellement, pendant que Biran fut écrire, dans une autre chambre, deux billets aux ducs de Foix et de La Ferté, par lesquels il les prioit de le venir trouver promptement chez la Madelon du Pré, qui étoit justement le lieu où il avoit fait entrer leurs femmes.
Les Ducs de Foix et de la Ferté, ayant reçu ces billets, se hâtèrent de se rendre au lieu désigné. Biran courut au devant d’eux, leur dire qu’ils ne seroient pas fâchés de la peine qu’ils avoient prise ; qu’il leur vouloit faire voir deux des plus jolies femmes de toute la ville, dont la du Pré avoit fait la découverte depuis peu. Il leur ouvrit en même temps la chambre où étoient les duchesses de La Ferté et de Foix, et, les leur présentant, il les pria d’en user si bien avec elles qu’elles ne s’en allassent pas mécontentes. Il est aisé de juger de l’étonnement de ces deux ducs, et encore plus de celui des deux duchesses, qui, sachant où elles étoient, voulurent prendre leur sérieux [89] avec Biran ; mais lui, les raillant tous quatre, il les obligea à en rire avec lui. Après il envoya quérir à dîner, et ils dînèrent tous cinq ensemble dans cet honnête lieu, quoique les femmes fissent mine de n’y vouloir pas demeurer davantage.
Comme elles virent néanmoins que c’étoit là la volonté de leurs maris, elles s’y laissèrent résoudre ; et pour ne pas s’ennuyer en attendant le dîner, elles dirent à la du Pré de leur faire passer ses religieuses en revue : ce que la du Pré fit, parce que, se doutant bien qu’elles étoient toutes de même confrairie, elle ne vouloit pas désobéir à celles qui méritoient bien d’être les abbesses du couvent.
Cependant la disgrâce de M. L’Avocat duroit toujours ; mais étant arrivé en ce temps-là un malheur au chevalier de Lignerac, (frère de l’abbé de Lignerac), qui avoit été mis en prison à la requête d’un nombre infini de personnes qu’il avoit attrapées, la duchesse de La Ferté l’envoya quérir, et lui dit qu’elle lui pardonnoit pourvu qu’il le fît sortir de prison. L’Avocat, qui savoit l’intrigue de l’abbé et d’elle, trouva bien rude qu’il fallût s’employer pour le frère de son rival, et que sa grâce ne fût qu’à ce prix-là ; mais comme elle l’avoit puni l’autre fois pour avoir dit la vérité, il n’osoit la dire cette fois-là, et il lui promit que, si le chevalier ne sortoit pas de prison, ce ne seroit pas manque d’y employer tout son crédit.
L’Avocat trouva de l’obstacle dans son entreprise ; tous les créanciers du chevalier de Lignerac furent crier aux oreilles des juges [90] et leur ayant fait voir qu’il avoit déjà fait cession de biens, et que depuis ce temps-là il avoit encore emprunté deux cent mille écus, sans avoir jamais eu ni servante ni laquais, les juges firent comprendre à L’Avocat qu’il leur étoit impossible de le mettre hors de prison, et il en fut rendre compte à la duchesse.
Il appréhendoit bien qu’elle ne le voulût rendre responsable de ce refus ; mais la duchesse, qui aimoit le nombre, et qui s’étoit quelquefois ennuyée de ne le point voir, lui dit qu’elle lui étoit obligée de la peine qu’il avoit prise, et qu’il pouvoit revenir chez elle quand il voudroit. L’Avocat se jeta à ses pieds pour la remercier, lui embrassa les genoux, et, lui protestant une fidélité éternelle, il lui dit que sa sœur la duchesse de Vantadour n’avoit pas la moitié de son mérite ; que quand il vivroit mille ans, il ne pourroit pas l’aimer un quart d’heure ; qu’elle diroit assurément qu’il n’avoit guère d’esprit, parce qu’il ne lui avoit jamais pu dire une seule parole, mais qu’il ne se soucioit pas en quelle réputation il fût auprès d’elle, pourvu qu’elle voulût bien considérer que tant d’indifférence pour une si aimable personne ne pouvoit procéder que de l’amitié qu’il lui portoit.
Comme il achevoit ces paroles, un laquais de la duchesse de Vantadour entra, et ayant présenté un billet de sa part à la duchesse de La Ferté, elle le prit et y lut ce qui suit :
Billet de la duchesse de Ventadour à la duchesse de La Ferté.
Un de mes bons amis a une affaire pardevant M. L’Avocat, et il la croit si délicate qu’il cherche à la faire recommander par tous ceux qui ont quelque crédit auprès de lui. Si j’avois prévu cet accident, j’aurois écouté volontiers quantité de sottises qu’il m’a voulu dire ; mais n’ayant pas le don de deviner, m’ennuyant d’ailleurs d’une si sotte conversation que la sienne, je l’ai prié un peu rudement de ne la pas continuer davantage ; ce qui fait que, ne le croyant pas bien intentionné pour moi, j’ai recours à vous pour lui recommander l’affaire de mon ami, dont je vous prie de faire la vôtre propre. Vous obligerez une sœur qui est toute à vous.
La duchesse de La Ferté, à qui L’Avocat venoit de protester qu’il n’avoit jamais pu dire une douceur à la duchesse de Ventadour, voyant le contraire dans cette lettre, fut tentée plus d’une fois de la lui montrer pour s’en divertir ; mais, craignant que cela ne nuisît au gentilhomme que sa sœur lui recommandoit, elle serra la lettre dans sa poche et renvoya le laquais, à qui elle commanda de dire à sa sœur qu’elle feroit ce qu’elle lui mandoit. Le laquais étant sorti, L’Avocat, qui étoit l’homme du monde le plus curieux, voulut savoir ce que contenoit la lettre, et, ne se contentant pas de ce que la duchesse lui en disoit, il chercha à lui mettre la main dans la poche et l’attrapa. Il lui dit alors qu’il verroit à ce coup-là leurs secrets ; mais qu’il n’y avoit pas beaucoup de danger pour lui, qui étoit de leurs amis.
La duchesse, qui, pour les raisons que j’ai dites, eût été bien aise qu’il ne l’eût pas vue, la lui voulut arracher ; mais, n’en ayant pu venir à bout, elle lui dit qu’il la désobligeroit s’il ne la lui rendoit à l’heure même. Mais L’Avocat, croyant que plus elle faisoit d’efforts pour la ravoir, plus elle étoit de conséquence, se tira à l’écart pour la lire, ce que la duchesse ne pouvant empêcher, il fut tout surpris d’y trouver des choses à quoi il ne s’attendoit pas.
Il dit en même temps à la duchesse que madame de Ventadour ne disoit pas vrai, qu’il ne lui avoit jamais parlé de rien, et que, pour lui faire voir qu’il ne l’avoit jamais estimée et qu’il ne l’estimoit pas encore, il feroit perdre son affaire à son ami. La duchesse de La Ferté lui dit qu’il n’en feroit rien, pour peu qu’il eût de considération pour elle ; que ce n’étoit plus l’affaire de sa sœur, mais la sienne propre ; qu’ainsi ce n’étoit pas avec la duchesse de Ventadour qu’il se brouilleroit, mais avec la duchesse de La Ferté. Madame de La Ferté eut beaucoup de peine à gagner cela sur lui ; mais lui ayant dit qu’elle ne croyoit rien de tout ce que madame de Ventadour lui mandoit, qui avoit un défaut commun avec toutes les belles femmes, qui étoit de prendre la moindre œillade pour une déclaration d’amour, elle lui donna moyen par là de se justifier auprès d’elle. Ainsi, L’Avocat, étant en si beau chemin, lui allégua qu’il falloit donc que madame de Ventadour eût interprété à son avantage quelques regards innocents ; et la duchesse, feignant de se confirmer toujours de plus en plus dans cette opinion, elle remit insensiblement son esprit, de sorte qu’il lui promit de faire tout ce qu’elle voudroit pour le gentilhomme en question.
[91] Pendant que tout ceci se passoit, l’on donna à la femme de Monsieur une fille d’honneur dont la beauté causa bientôt des désirs à tous les courtisans et de la jalousie à toutes ses compagnes. Elle étoit d’une taille ravissante, si bien que la médisance, qui a coutume de mordre sur toutes choses, se trouva en défaut à ce coup-là. De fait, tout ce qu’il y avoit de gens de l’un et de l’autre sexe fut obligé d’avouer qu’il n’avoit jamais rien vu de si accompli. Le grand Alcandre, qui aimoit alors madame de Montespan, plutôt par habitude que par délicatesse, ne l’eût pas plutôt vue qu’il en fut charmé. Mais comme il ne vouloit plus faire l’amour en jeune homme, mais en grand roi, il lui fit parler par un tiers ; et afin que ses offres de service fussent mieux reçues, il les accompagna d’un fil de perles et d’une paire de boucles d’oreilles de diamans de grand prix.
Cependant, madame de Montespan étoit dans des alarmes mortelles que cette jeune beauté ne lui enlevât le cœur de ce prince, avec qui elle avoit eu du bruit il n’y avoit que peu de jours : car, prétendant qu’il la dût toujours traiter comme il avoit fait dans le commencement, elle lui avoit reproché qu’il n’avoit plus de complaisance pour elle. Comme il étoit assez naturel, et qu’il n’aimoit pas à être gêné, il lui avoit répondu franchement qu’il y avoit trop longtemps qu’ils se connoissoient pour observer tant de cérémonies ; ce qui avoit été cause qu’elle s’étoit emportée, même jusqu’à lui dire des choses fort désobligeantes. Elle lui avoit d’abord reproché tout ce qu’elle avoit fait pour lui : qu’elle avoit quitté maison, enfans, mari et jusqu’à son honneur pour le suivre ; qu’il n’y avoit sorte de complaisance qu’elle ne lui témoignât tous les jours pour l’engager ; mais qu’il étoit devenu si froid, qu’il n’étoit plus reconnoissable ; que si c’étoit que les années lui eussent apporté quelques défauts, il ne s’en devoit pas prendre à elle, mais au temps, qui a coutume de détruire toutes choses ; que cependant elle ne s’apercevoit pas encore, grâce à Dieu, qu’il y eût un si grand changement en sa personne ; mais que pour lui, elle lui pouvoit dire, sans avoir dessein néanmoins de le fâcher, que, quoiqu’il eût beaucoup de lieu de se louer de la nature, il n’étoit pas exempt néanmoins de certains défauts, qui étoient un grand remède à l’amour ; qu’il en avoit un grand entre autres, dont peut-être il ne s’apercevoit pas, mais dont elle s’étoit bien aperçue, sans s’en être plainte néanmoins, parce qu’elle croyoit qu’on n’y devoit pas prendre garde de si près avec une personne qu’on aimoit.
Le grand Alcandre, à qui personne n’avoit jamais osé rien dire d’approchant, fut extrêmement touché de se l’entendre dire par madame de Montespan, pour qui il n’avoit guère moins fait qu’elle avoit fait pour lui : car, si elle avoit quitté maison, enfans et mari pour le suivre, il avoit quitté pour elle le soin de sa réputation, qui étoit extrêmement flétrie pour avoir aimé une femme qu’il avoit de si grandes raisons de ne pas regarder comme il avoit fait. Néanmoins, bien que les injures qu’on reçoit des personnes que l’on aime soient beaucoup plus sensibles que celles que l’on reçoit des autres, il ne laissa pas tomber ce reproche à terre, et, demandant à madame de Montespan quels étoient donc ces défauts, il lui reprocha lui-même les siens, dont madame de Montespan fut si touchée, qu’elle lui répondit que si elle avoit les imperfections dont il l’accusoit, du moins elle ne sentoit pas mauvais comme lui.
Comme c’étoit dire par là au grand Alcandre tout ce qu’il y avoit de plus désobligeant, il est impossible de dire combien ce reproche lui fut sensible. Il lui répondit de son côté des choses qui la devoient toucher et la faire rentrer en elle-même, si elle eût eu encore quelques sentimens de vertu ; mais, s’étant entièrement abandonnée à ses passions, elle continua ses reproches, qui n’auroient pas fini si tôt, sans ce que je vais rapporter. Il faut savoir que, comme ils se querelloient ainsi fortement, le prince de Marsillac [92] arriva à la porte du cabinet où ils étoient. Le grand Alcandre lui avoit permis d’entrer partout où il seroit, sans en demander permission : ainsi, il avoit déjà le pied dans la porte, quand il entendit au son de la voix de ce prince qu’il étoit en colère. Il s’arrêta tout court, et étant bien aise de savoir s’il trouveroit bon qu’il entrât, il commença à crier tout haut : « Huissier ! huissier ! » Et comme il n’y en avoit point, il dit encore plus haut : « Qui est-ce donc qui m’annoncera, et comment m’annoncer moi-même ? » Le grand Alcandre, qui prêtoit l’oreille à ce qu’il disoit, jugea bien, après la permission qu’il lui avoit donnée, que ce qu’il en faisoit n’étoit que par discrétion ; et étant bien aise d’avoir lieu de quitter une conversation si désagréable, il dit au prince de Marsillac qu’il pouvoit entrer : ce qui fut cause que madame de Montespan tâcha de se contraindre, de peur que le bruit de sa disgrâce, qu’elle vouloit cacher, ne courût toute la cour.
Étant sortie un moment après, elle laissa le grand Alcandre dans la liberté d’ouvrir son cœur au prince de Marsillac, qui avoit grande part dans sa confiance, et à qui il avoit donné en moins d’un an pour plus de douze cent mille francs de charges : car incontinent après la disgrâce de M. de Lauzun, il l’avoit obligé de prendre le gouvernement de Berri, que ce favori avoit, et qu’il ne vouloit pas accepter, parce que, n’ayant jamais été de ses amis, il avoit peur qu’on ne dît dans le monde qu’il auroit poussé le grand Alcandre à le faire arrêter afin de profiter de ses dépouilles.
Le grand Alcandre trouva que sa délicatesse étoit d’autant plus belle qu’elle étoit rare dans les courtisans ; et comme elle ne pouvoit partir que d’un grand cœur, il l’eut encore en plus grande estime. A quelque temps de là, il lui donna encore la charge de grand maître de la garde-robe, vacante par la mort du marquis de Guitry, qui avoit été tué au passage du Rhin [93]. Mais il la lui donna d’une manière si obligeante, que le présent étoit moins considérable par sa grandeur en lui-même que par la bonté qu’il lui témoigna en le lui faisant : car il lui dit qu’il ne lui donnoit cette charge que pour accommoder ses affaires, et non pour l’incommoder ; que s’il lui étoit plus utile de la vendre que de la garder, il lui vouloit chercher lui-même un marchand, et qu’il lui en feroit donner un million.
Le grand Alcandre continua toujours ainsi de lui donner des marques de son amitié, et les autres courtisans le regardoient comme une espèce de favori, mais bien plus digne d’occuper cette place que M. de Lauzun, qui méprisoit tout le monde, comme s’il n’y eût personne digne de l’approcher. Cependant cette faveur, qui ne laissoit pas de donner de la jalousie à un chacun, augmenta encore de beaucoup par le refroidissement où le grand Alcandre étoit tombé pour madame de Montespan et par la nouvelle passion qu’il se sentoit pour mademoiselle de Fontanges [94], qui étoit cette fille d’honneur de la femme de Monsieur dont j’ai parlé ci-devant : car le grand Alcandre ayant communiqué l’un et l’autre au prince de Marsillac, voulut que ce fût lui qui lui ménageât les bonnes grâces de cette fille ; à quoi le prince de Marsillac n’eut pas beaucoup de peine, n’étant venue à la Cour que dans le dessein de plaire au grand Alcandre.
En effet, ses parents, la voyant si belle et si bien faite, et ayant plus de passion pour leur fortune que de soin pour leur honneur, boursillèrent entre eux pour pouvoir l’envoyer à la cour et pour lui faire faire une dépense honnête et conforme au poste où elle entroit [95]. Or, comme ils lui avoient donné des leçons là-dessus, elle les mit en pratique dès le moment que le prince de Marsillac lui eut parlé de la part du grand Alcandre. Elle lui dit donc qu’elle recevoit avec joie la déclaration qu’il venoit de lui faire de sa part ; que ce prince avoit des qualités si touchantes qu’il faudroit qu’elle fût de bien mauvaise humeur pour n’être pas charmée de sa passion ; mais qu’avec tout cela elle ne pouvoit pas prendre grande confiance en ce qu’il venoit de lui dire, tant que madame de Montespan posséderoit ses bonnes grâces ; qu’elle étoit jalouse naturellement ; qu’ainsi elle ne seroit point fâchée que le grand Alcandre sût que, quoiqu’il y eût beaucoup de gloire à posséder la moindre partie de son cœur, elle étoit assez délicate, néanmoins, pour n’en vouloir à ce prix-là ; qu’aussi bien ce n’étoit peut-être pas une véritable passion que celle qu’il sentoit pour elle, mais quelque feu passager qui seroit aussitôt éteint qu’allumé ; que s’il étoit vrai cependant que ce prince l’aimât véritablement, ce qu’elle n’osoit croire encore, de peur de s’abandonner à une joie mal fondée, il lui en donneroit des marques bientôt en n’aimant qu’elle uniquement, comme elle étoit prête de son côté de n’aimer que lui.
Le prince de Marsillac, qui vouloit réussir du premier coup dans son ambassade amoureuse, répondit à cela que, si l’on pouvoit juger de l’avenir par les choses passées, il n’y avoit pas beaucoup d’apparence que le grand Alcandre, qui étoit mécontent de madame de Montespan, dût jamais retourner vers elle ; qu’il étoit constant quand il aimoit une fois, et que s’il avoit quitté madame de La Vallière, c’est que cette dame y avoit beaucoup contribué par une inégalité d’esprit qui ne plaisoit pas à ce prince ; qu’elle avoit pu entendre parler qu’avant qu’elle entrât dans le couvent où elle étoit religieuse, elle étoit déjà entrée dans un autre malgré lui ; qu’il avoit été obligé même de la renvoyer quérir, et cela à la vue de tout son royaume ; que depuis ce temps-là elle ne faisoit que lui parler des sindérèses de sa conscience, ce qui l’avoit détaché d’elle peu à peu, ce prince ne voulant pas s’opposer à son salut ; qu’il avoit donc aimé madame de Montespan, et qu’il l’aimeroit peut-être toujours, si elle n’avoit voulu prendre avec lui des airs qui peuvent bien convenir aux maîtresses des particuliers, mais non pas à celle d’un grand prince, avec qui il est bon d’avoir l’esprit plus souple et plus complaisant ; qu’il lui diroit comment elle en devoit user quand elle en seroit là ; mais que n’en étant pas encore temps, il ne s’agissoit que de mettre son esprit en repos : c’est pourquoi il vouloit bien lui dire, en bon ami, de ne pas laisser échapper une si belle occasion ; qu’autrement il étoit assuré qu’elle s’en repentiroit toute sa vie.
Il lui conta là-dessus la querelle que le grand Alcandre avoit eue avec madame de Montespan, l’insolence de cette dame, le ressentiment de ce prince ; et cette circonstance l’ayant convaincue plutôt que toutes ses raisons, elle manda au grand Alcandre que si elle lui étoit obligée du présent qu’il lui avoit fait, et dont j’ai parlé ci-devant, elle lui savoit encore bien meilleur gré de ce qu’il lui avoit fait dire par le prince de Marsillac, qui lui serviroit de caution qu’elle étoit toute prête à se donner à lui, pourvu qu’il voulût bien se donner à elle.
Cependant, madame de Montespan, qui se défioit de cette intrigue, employoit tous ses amis pour regagner la confiance du grand Alcandre. Le marquis de Louvois, qui en étoit, et même des plus affectionnés, lui conseilla de chercher l’occasion de lui parler en particulier. Mais comme le grand Alcandre tenoit sa colère et qu’il la fuyoit avec grand soin, elle dit au marquis de Louvois qu’il lui étoit impossible de le retrouver tête à tête, et que, s’il ne s’y employoit comme il faut, elle n’en viendroit jamais à bout. Ce marquis lui dit de se rendre de bonne heure où le grand Alcandre avoit coutume de tenir conseil, et de prendre si bien son temps qu’elle ne le laissât pas aller sans se raccommoder avec lui.
Madame de Montespan, ayant approuvé ce conseil, se rendit au lieu désigné. Le grand Alcandre y étant venu, il fut tout surpris de l’y rencontrer au lieu des ministres. Cependant, M. de Louvois, qui vouloit leur donner le temps de faire leurs affaires, entra dans la chambre tout proche du lieu où ils étoient, et voyant qu’il y avoit sept ou huit personnes de la cour qui avoient coutume de se faire voir quand le grand Alcandre sortoit, il prît une bougie de dessus un guéridon, feignant de chercher un diamant qu’il disoit avoir perdu. Il se doutoit bien que les valets de chambre viendroient à lui pour lui aider à le chercher, et en étant venu un, il lui dit tout bas, en lui donnant le flambeau, qu’il fît sortir tous ceux qui étoient dans la chambre, et qu’il dît à l’huissier de n’y laisser entrer personne, pas même ceux qui étoient mandés pour le conseil.
Ainsi, sans qu’on s’aperçut que cela vînt de lui, il se défit de tous ces importuns, et au lieu d’y avoir conseil ce jour-là, il y eût un grand éclaircissement entre le grand Alcandre et madame de Montespan. Cependant, comme l’on savoit que M. de Louvois étoit demeuré dans la chambre, on le crut enfermé avec le prince ; de sorte que les autres ministres, qu’on avoit renvoyés sans les vouloir laisser entrer, en eurent de la jalousie. Et de fait, ils ne surent à quoi attribuer cette longue conversation qui étoit cause qu’il n’y avoit point eu de conseil ce jour-là ; ce qui n’étoit point encore arrivé, le grand Alcandre étant ponctuel dans tout ce qu’il faisoit.
Cependant, quoique cet éclaircissement semblât avoir raccommodé toutes choses, et que le grand Alcandre retournât à son ordinaire chez madame de Montespan, il ne laissa pas que de poursuivre sa pointe avec mademoiselle de Fontanges [96].
Il la vit en particulier, et il lui donna des marques de son affection et en reçut de la sienne ; ce qui ne put être si secret que toute la cour n’en fût bientôt abreuvée.
Le grand Alcandre fut si content de cette nouvelle conquête, qu’il donna au prince de Marsillac la charge de grand-veneur [97], pour récompense de la lui avoir procurée.
[ [98] Cependant, comme il étoit sujet à trouver des maîtresses fécondes, il sut bientôt que mademoiselle de Fontanges étoit grosse ; ce qui l’obligea à lui donner le titre de duchesse [99], et à faire sa maison. Comme cette demoiselle, bien loin de ressembler à madame de Montespan, dont l’avarice alloit jusqu’à la vilenie, étoit généreuse jusqu’à la prodigalité, il fut obligé aussi de lui donner un homme pour retenir cette humeur libérale [100], et pour prendre garde qu’elle pût subsister avec cent mille écus par mois qu’il lui donnoit. Ce surintendant fut le duc de Noailles [101], dont on fut extrêmement surpris : sa dévotion sembloit incompatible avec un emploi qui le faisoit entrer dans beaucoup de petits détails dont il auroit pu se passer honnêtement. Mais comme chacun s’étoit mis sur le pied de songer en premier lieu à sa fortune, et ensuite à Dieu, ce duc, bien loin de refuser cet emploi, remercia le grand Alcandre de le lui avoir donné préférablement à beaucoup d’autres qui le briguoient aussi bien que lui. Ainsi il partagea son temps entre ce prince et sa maîtresse, qui fut alors appelée Madame ; et quand il en avoit de reste, il le donnoit à Dieu.]
[ [102] Cependant madame de Montespan tâchoit de se soutenir encore le mieux qu’il lui étoit possible ; elle avoit prié le grand Alcandre de vouloir du moins venir chez elle comme il avoit accoutumé, et elle tâchoit d’insinuer à tout le monde que son crédit étoit encore plus grand qu’on ne pensoit ; que l’amour du grand Alcandre pour madame de Fontanges n’étoit qu’un amour passager et dont il seroit bientôt revenu ; et qu’enfin il reviendroit à elle plus amoureux qu’il n’avoit jamais été. Ses partisans tâchoient d’ailleurs de donner quelque crédit à ces faux bruits ; mais comme on voyoit que ce prince s’adonnoit entièrement à sa nouvelle passion, chacun rechercha les bonnes grâces de madame de Fontanges, qui procura des établissements aux uns et aux autres, de même qu’à la plupart de sa famille.]
Madame de Montespan, voyant que le grand Alcandre se détachoit d’elle tous les jours de plus en plus, en conçut tant de rage qu’elle commença à médire publiquement de madame de Fontanges. Elle disoit à chacun qu’il falloit que le grand Alcandre ne fût guère délicat, d’aimer une fille qui avoit eu des amourettes dans sa province ; qu’elle n’avoit ni esprit ni éducation, et qu’enfin, à proprement parler, ce n’étoit qu’une belle peinture. Elle en disoit encore mille autres choses aussi fâcheuses, ce qui, bien loin de ramener le grand Alcandre comme elle pensoit, le détourna encore davantage de revenir à elle. En effet, il lui voyoit toujours le même esprit d’orgueil qu’il n’avoit jamais pu humilier, et qui étoit encore tout prêt de lui faire mille algarades. Il s’en plaignit au prince de Marsillac, qui l’entretint dans l’aversion qu’il se sentoit pour elle, et qui en sut faire sa cour ensuite à madame de Fontanges.
Cependant cette fille vint à accoucher peu de temps après, et on prit ce temps-là, à ce qu’on croit, pour l’empoisonner [103], ce que l’on a attribué à madame de Montespan, soit qu’on s’imagine qu’une personne dans le chagrin où elle étoit dût se porter à un si grand crime, ou qu’on croie que, dans le poste où étoit madame de Fontanges, et ayant une rivale sur les bras, elle ne dût mourir que d’une mort violente. Quoi qu’il en soit, elle tomba dans une langueur incontinent après ses couches, dont il lui resta une perte de sang, ce qui empêcha le grand Alcandre de coucher davantage avec elle. Cependant il la visitoit souvent, lui témoignant le déplaisir où il étoit de l’état où il la voyoit réduite. Mais madame de Fontanges, qui se voyoit mourir tous les jours, le pria de permettre qu’elle se retirât de la cour, ajoutant en pleurant que la malice de ses ennemis étoit cause qu’elle ne devoit plus songer qu’à l’autre monde.
[ [104] Le grand Alcandre, qui étoit bien aise qu’elle donnât ordre aux affaires de son salut, et qui d’ailleurs étoit sensiblement touché d’être présent à ses souffrances, lui accorda ce qu’elle lui demandoit. Elle se retira dans un couvent au faubourg Saint-Jacques [105], où il envoyoit tous les jours savoir de ses nouvelles. Le duc de La Feuillade y alloit aussi deux ou trois fois la semaine la visiter de sa part, mais il n’en rapportoit jamais que de méchantes nouvelles ; car cette pauvre dame, qui avoit toutes les parties nobles gâtées, soit de poison ou d’autre chose, se voyoit décliner tous les jours ; de sorte que le duc de La Feuillade dit au grand Alcandre que c’en étoit fait et qu’il n’y avoit plus d’espérance. En effet, elle mourut peu de jours après, laissant encore plus de soupçon après sa mort d’avoir été empoisonnée qu’on n’en avoit eu pendant sa maladie : car l’ayant ouverte, on trouva qu’il y avoit de petites marques noires attachées aux parties nobles, lesquelles sont des témoignages indubitables, à ce que l’on prétend, qu’elle a été empoisonnée].
Le grand Alcandre témoigna publiquement la douleur qu’il avoit de sa perte, et, voulant faire voir que l’estime qu’il avoit eue pour elle duroit encore après sa mort, il donna une abbaye à un de ses frères [106] ; il maria aussi une de ses sœurs [107] fort avantageusement, et fit encore quantité d’autres choses en faveur de sa famille [108]. Madame de Montespan croyoit cependant que ce prince alloit revenir à elle ; mais [109] elle fut tout étonnée de voir que madame de Maintenon [110] avoit toute sa confiance. Elle en fut au désespoir : car, comme c’étoit elle qui l’avoit faite ce qu’elle étoit, elle ne pouvoit souffrir que son propre ouvrage servît à la détruire elle-même.
Ce qui la chagrinoit encore davantage, c’est qu’elle ne croyoit pas qu’il entrât aucune foiblesse dans leur intelligence, qui devoit être par conséquent de plus longue durée, puisqu’elle ne dépendoit point d’un amour passager, qui commence et finit souvent tout en un même jour. En effet, elle a vu que la confiance que le grand Alcandre a prise en cette dame subsiste encore aujourd’hui, et qu’au contraire l’amour qu’il a eu pour elle a dégénéré en une espèce de mépris. Cependant il ne lui en fait rien paroître, sachant qu’une certaine honnêteté de bienséance est toujours le reste de l’amour d’un honnête homme, qui en use ainsi plutôt pour sa propre réputation, que pour conserver encore quelque sentiment de tendresse.
Il sembloit que, le grand Alcandre ayant renoncé à l’amour, chacun y dût renoncer de même, et que les dames, à l’exemple de madame de Montespan, qui fait maintenant la prude, dussent être prudes aussi ; mais leur tempérament et leur inclination l’emportant par dessus toutes sortes de raisons, elles continuent toujours la même vie. La duchesse de La Ferté surtout est plus emportée que jamais dans ses plaisirs. La duchesse de Vantadour, sa sœur, n’en est pas moins friande, quoiqu’elle fasse ses affaires avec plus de discrétion et de conduite. Pour ce qui est de la maréchale de La Ferté, elle est à qui plus donne, et est revêtue d’une si grande humilité, depuis certains malheurs qui lui sont arrivés, semblables à ceux que j’ai rapportés de sa belle-fille, qu’elle a fait vœu de ne refuser personne, pourvu qu’il ait de l’argent. Ses débauches, qui vont jusqu’à l’excès, feroient un gros volume, si on se donnoit la peine de les écrire. On en verra un échantillon dans un manuscrit qui m’est tombé entre les mains [111] et où on lui rend justice, aussi bien qu’à une autre dame [112] de son calibre [113]. On y verra quelques aventures qui ont du rapport avec celle-ci ; mais comme c’est une autre main qui a fait son histoire, on la donnera au public telle qu’on l’a reçue.
[ [114] Pour ce qui est de mademoiselle de Montpensier, après avoir pleuré pendant dix ans entiers la prison de M. de Lauzun, enfin elle a trouvé moyen d’obtenir sa liberté : car, considérant que tous les biens du monde ne sont rien en comparaison de son contentement, elle a apaisé la colère du grand Alcandre moyennant la principauté de Dombes et la comté d’Eu qu’elle a assurées au duc du Maine, son fils naturel. Par ce moyen-là M. de Lauzun est revenu, non pas à la cour, mais à Paris, où il est obligé de vivre en homme privé. En effet, le grand Alcandre n’a pas voulu permettre que son mariage se déclarât ; mais il est si souvent chez la princesse, que c’est tout de même que s’il y logeoit. Cependant elle en est si jalouse, qu’il voudroit bien n’avoir jamais songé à elle [115]. Elle a mis des espions auprès de lui, et il n’ose faire un pas qu’elle n’en soit avertie. Ainsi, l’on peut dire de lui qu’en sortant d’une prison il est rentré dans une autre, qui ne lui semble pas moins rude. Elle lui a donné deux terres [116], du consentement du grand Alcandre ; mais c’est tout ce qu’elle a fait pour lui, car elle ne sauroit lui donner un sou, ayant perdu tout son crédit par ce mariage, personne ne lui voulant plus prêter d’argent, de peur qu’on ne dise un jour à venir qu’étant en puissance de mari elle n’a pu emprunter valablement. C’est ce qui fait qu’il y a bientôt quatre ou cinq ans qu’elle a commencé à bâtir sa maison de Choisi [117], sans qu’elle soit achevée, car il faut qu’elle prenne cette dépense sur son revenu. Mais elle se consoleroit encore de tout cela, si M. de Lauzun étoit le même qu’il a été autrefois, je veux dire s’il étoit toujours aussi brave homme avec les dames qu’il l’étoit dans le temps de sa faveur. Mais on dit que c’est maintenant si peu de chose, qu’on auroit peine à juger de ce qu’il a été autrefois par ce qu’il est aujourd’hui. Cependant, c’est un défaut qui lui est commun avec beaucoup d’autres : car on sait par expérience qu’il faut que toutes choses prennent fin. C’est pour cela aussi que la princesse dit aujourd’hui que celui-là a menti bien impudemment, qui a dit le premier que tout bon cheval ne devient jamais rosse.]
FIN DU TOME II.
Le nom de grand Alcandre, qui étoit celui du roi Henri IV dans le pamphlet célèbre attribué à la princesse de Conti, a été depuis appliqué à Louis XIV, l’homme puissant (du grec Αλκη et ανηρ, ανδρος) ; et quand parurent, en 1695, les Intrigues amoureuses de la cour de France, l’éditeur de Cologne, rappelant le succès des Conquêtes amoureuses du grand Alcandre, ajoute : « Ce livre… a été si bien reçu en France que le nom de grand Alcandre est aujourd’hui en usage quand on veut parler du Roi. » Nous ne nous permettrons donc pas de substituer le nom du Roi à celui-ci, qu’on retrouve dans tous les pamphlets du temps. Madame de Montespan étoit Françoise-Athénaïs de Rochechouart, fille de Gabriel, marquis de Mortemart, et de Diane de Grandseigne. Née en 1641, elle épousa, en 1663, Henri-Louis de Gondrin de Pardaillan, marquis de Montespan et d’Antin, et mourut le 28 mai 1707.
Celui-ci étoit le troisième fils de Roger-Hector de Pardaillan de Gondrin et de Marie-Christine Zamet, fille unique et héritière de Sébastien Zamet. La mort de ses deux frères aînés laissa le marquis Henri-Louis maître d’une fortune considérable, qui lui étoit venue tant de son père que de son grand-père maternel, lequel se disoit « seigneur de dix-huit cent mille écus. »
« J’ai beaucoup d’inclination pour elle, qui est fort aimable, dit mademoiselle de Montpensier ; c’est une race de beaucoup d’esprit, et d’esprit fort agréable, que les Mortemart. » (Mém. de Montpensier, VII, 42.) Voy. ci-dessus, p. 151. Voy. t. 1, p. 111. Voy. ci-dessus, et t. 1, p. 132 et suiv. Voy. t. 1, p. 134 et 138. Voy. t. 1, p. 134, le passage cité de l’abbé de Choisy, qui montre Lauzun laissant toute une nuit Louis XIV se morfondre dans un corridor, à la porte de madame de Monaco. Il étoit alors colonel-général des dragons. Saint-Simon fait le même récit (t. 20, édit. Sautelet). Mme de Monaco mourut en juin 1678. Voy. t. 1, p. 138. Mademoiselle de Montpensier dit, avec sa malignité familière : « Elle est une bonne religieuse et passe présentement pour avoir beaucoup d’esprit ; la grâce fait plus que la nature, et les effets de l’une lui ont été plus avantageux que ceux de l’autre. » (VI, 355.) Madame de La Vallière vit madame de Montespan prendre sa place sans lui en témoigner de jalousie. Madame de Sévigné, dans sa lettre à sa fille du 22 février 1671, nous dit avec quel regret elle se voit abandonnée du Roi, et prend le parti de quitter la cour : « Le Roi pleura fort et envoya M. Colbert à Chaillot la prier instamment de venir à Versailles, et qu’il pût lui parler encore. M. Colbert l’y a conduite ; le Roi a causé une heure avec elle et a fort pleuré. Madame de Montespan fut au-devant d’elle, les bras ouverts et les larmes aux yeux. »
Madame de La Vallière resta encore quelque temps à la cour, sur les instances du Roi. Enfin elle se décida à entrer en religion. La veille du jour où elle quitta à jamais la cour, elle soupa chez madame de Montespan (Mém. de madem. de Montp., VI, 355), et c’est là qu’elle reçut les adieux de Mademoiselle. Quelques années après, en 1676, madame de Montespan alloit encore visiter aux Carmélites sœur Louise de la Miséricorde et ne craignoit pas de lui rappeler le souvenir du Roi. (Sévigné, Lettre du 29 avril 1676.) La même année nous voyons madame de Montespan aux eaux de Bourbon. Le frère de madame de La Vallière, gouverneur de la province, donna des ordres pour qu’on vînt la haranguer de toutes les villes de son gouvernement ; elle ne l’a point voulu, ajoute madame de Sévigné (Lettre du 17 mai 1676). Il n’est donc pas étonnant que madame de La Vallière et son frère aient surpris tout le monde par leur conduite vis-à-vis de la nouvelle favorite.
Madame de Montespan avoit eu deux enfants, une fille qui mourut jeune, et un fils, Louis-Antoine de Gondrin de Pardaillan, qui obtint du Roi les plus hautes dignités et fut connu sous le nom de duc d’Antin. Il épousa la petite-fille de M. de Montausier, mademoiselle de Crussol, fille du duc d’Usez. Voy. t. 1, p. 135 et suiv. Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, né le 31 mars 1670, légitimé par lettres du 19 décembre 1673. « J’ai ouï conter à M. de Lauzun que le jour qu’elle accoucha de M. du Maine, c’étoit à minuit sonnant, le dernier jour de mars, ou le premier d’avril si l’on veut, on n’eut pas le temps de l’emmailloter ; on l’entortilla dans un lange, et il le prit dans son manteau et le porta dans son carrosse, qui l’attendoit au petit parc de Saint-Germain : il mouroit de peur qu’il ne criât. » (Mém. de Montpensier, t. 6, p. 352.) On sait que mademoiselle de Montpensier lui abandonna la principauté de Dombes et le comté d’Eu pour obtenir la liberté de Lauzun et la permission de l’épouser. Madame de Montespan, qui avoit négocié cette affaire dans l’intérêt de son fils, ne promit rien en laissant tout espérer. Mademoiselle, le contrat passé, eut grand’peine à obtenir la mise en liberté du marquis. Madame de Montausier mourut le 14 novembre 1671. Anne Poussart, fille du marquis de Fors du Vigean, veuve du marquis de Pons, épousa en secondes noces Armand-Jean du Plessis, petit-neveu du cardinal duc de Richelieu, qui le substitua à son nom et à son titre de duc de Richelieu. La duchesse de Richelieu, mariée en 1649, mourut en 1684. Elle devint plus tard dame d’honneur de la Dauphine, et fut remplacée dans sa charge de dame d’honneur de la Reine par madame de Créqui. Voy. ci-dessus, p. 80. Madame de Nogent. Voy. p. 222 et 248. Il n’est nullement question, dans les Mémoires de Mademoiselle, de ce projet qu’auroit eu Lauzun d’acheter le titre et les droits du duc de Lorraine. Voy. ci-dessus, p. 271. Ce n’étoient pas des parents de Lauzun, mais des gentilshommes qui venoient, au nom de la noblesse, demander cette faveur dont tout le corps étoit honoré. Voy., p. 271, le texte et la note 1. « M. de Louvois et M. Le Tellier, son père, avoient toujours été fort contraires à M. de Lauzun : celui-ci ne lui avoit jamais pardonné l’amour qu’il avoit eu pour sa fille, madame de Villequier ; pour l’autre, qui vouloit être le maître de la guerre, et que toutes les charges qui la regardoient et les commandements dépendissent de lui, il ne pouvoit souffrir la grande ambition de M. de Lauzun, qui vouloit pousser sa fortune par là et qui étoit incapable de se soumettre à lui. La grande inclination que le Roi avoit pour lui, tout cela lui donnoit beaucoup de jalousie contre M. de Lauzun. On disoit que c’étoit lui qui avoit empêché qu’il ne fût grand maître de l’artillerie, lorsque le comte de Lude le fut. Ils avoient eu mille démêlés ensemble, et M. de Lauzun prenoit toujours les affaires d’une grande hauteur ; ainsi on l’accusoit fort d’avoir contribué à sa prison. » (Mém. de Montp., t. 6, p. 346.) On a tout lieu de penser que la sœur même de Lauzun, madame de Louvois, étoit gagnée par Louvois et trahissoit son frère. « S’ils croyoient, disoit Lauzun, parlant d’elle et de son mari, que j’eusse de l’argent dans les os, ils me les casseroient. » Mademoiselle dit ailleurs : « Quoique M. de Louvois ne fût pas ami de M. de Lauzun, madame de Nogent a toujours continué de commercer avec lui ; et j’ai su qu’elle lui avoit promis, peu de temps après sa prison, qu’elle ne feroit jamais rien pour sa liberté sans son ordre, et que si je voulois agir pour cela et qu’elle en eût connoissance, il en seroit averti. » (Mém., VI, 344 et 345.) L’histoire de ses amours et de sa disgrâce est l’objet du premier pamphlet de ce volume. « Le régiment des gardes françoises est le premier et le plus considérable de l’infanterie. Il est composé de trente compagnies, et chaque compagnie de deux cents hommes. » (État de la France.) — D’après Saint-Simon (t. 20, édit. Sautelet), ce n’est pas la charge de colonel du régiment des gardes, mais celle de grand-maître de l’artillerie, qu’auroit poursuivie Lauzun. Cf. ci-dessus, p. 390, note 1. Le duc de Créqui avoit été un des quatre gentilshommes qui avoient parlé au roi en faveur du mariage de Lauzun et de Mademoiselle. Mademoiselle de Montpensier semble douter de la part que prit madame de Montespan à la disgrâce du Lauzun : « On croyoit, dit-elle, que madame de Montespan, qui avoit été fort de ses amies, avoit changé. On n’en disoit pas la raison : on ne doit pas croire que mon affaire, qui ne paroissoit point être désagréable au Roi, l’ait pu être à elle…. Je crois que ce fut son malheur seul qui lui attira celui-là. » Cependant Mademoiselle n’ignoroit pas les rapports de Lauzun avec madame de Montespan : « Il avoit, à ce que l’on dit, souvent des démêlés avec madame de Montespan. Cela n’est pas venu à ma connoissance, et je ne m’en suis pas informée. » On voit que mademoiselle de Montpensier s’aveugloit volontairement (Mém., VI, 346-348). Segrais, confident de mademoiselle de Montpensier et disgracié par elle, parce qu’il lui parloit trop franchement au sujet de Lauzun, s’explique ainsi sur l’arrestation de celui-ci : « Lorsque M. de Lauzun sut que c’étoit madame de Montespan qui avoit empêché que son mariage ne s’accomplît avec Mademoiselle, il conçut une haine implacable contre elle et il commença à se déchaîner contre sa conduite, non-seulement dans toutes les occasions et dans toutes les compagnies où il se trouvoit, mais encore à deux pas d’elle, de telle manière qu’elle avoit entendu dire des choses très cruelles de sa personne. Madame de Maintenon, qui étoit auprès de madame de Montespan, sachant que le Roi avoit résolu de faire la guerre aux Hollandois, comme il la fit en 1672, lui demanda ce qu’elle prétendoit devenir lorsque la guerre seroit déclarée, et si elle ne considéroit pas que M. de Lauzun, qui étoit si bien dans l’esprit du Roi et qui auroit lieu d’entretenir souvent le Roi par le rang que sa charge lui donnoit, lui rendroit de mauvais offices pendant qu’elle resteroit à Versailles. Madame de Montespan, effrayée par les sujets de crainte que madame de Maintenon venoit de lui dire, lui demanda quel remède on pourroit y apporter. Elle répondit que c’étoit de le faire arrêter, et qu’elle en avoit un beau prétexte, en représentant au Roi toutes les indignités dont elle savoit que M. de Lauzun la chargeoit tous les jours, et qu’il n’en falloit pas davantage pour obliger le Roi de la délivrer d’un ennemi si redoutable. Elle fit ses plaintes et M. de Lauzun fut arrêté. » (Mém. anecdotes de Segrais ; œuvres, Paris, 1755, in-12, t. 2, p. 92.) L’État de la France de 1669 et années suivantes mentionne en effet le chevalier de Fourbin ou Forbin comme « major, reçu lieutenant, et précédant tous les lieutenants reçus depuis lui. » Melchior, chevalier de Forbin, étoit fils du marquis Gaspard de Forbin-Janson et de Claire de Libertat, sa seconde femme ; son frère aîné, marquis de Janson, étoit gouverneur d’Antibes, et son frère le plus jeune, cardinal évêque de Beauvais. Le chevalier de Forbin fut tué au combat de Casano. (Saint-Simon.) Il y avoit deux compagnies de mousquetaires à cheval, et toutes deux avoient pour capitaine le roi ; le capitaine lieutenant de la première étoit Charles de Castelmar, seigneur d’Artagnan, dont Gatien des Courtils a publié les mémoires apocryphes ; le capitaine lieutenant de la seconde étoit un Colbert. La citadelle de Pignerolles avoit pour gouverneur M. de Saint-Mars. Lauzun y trouva Fouquet, avec qui il avoit été brouillé pour je ne sais quelle galanterie, et avec qui il se réconcilia. Ils mangeoient presque tous les jours ensemble, dit Mademoiselle. Mais avant d’obtenir cette faveur, Lauzun avoit pu déjà, à force de patience, de ruse et d’industrie, entrer en correspondance avec Fouquet. C’est un passage charmant dans Saint-Simon que celui où l’on voit Lauzun raconter son élévation, et son mariage rompu avec Mademoiselle, à Fouquet, qui ne l’en peut croire, et le plaint d’une captivité qui lui a fait perdre la tête. On eut toutes les peines du monde à le désabuser. (Saint-Simon, XX, 438.) Il avoit ce titre depuis janvier 1672, que sa femme, Charlotte Gouffier, lui avoit apporté le duché de Roannez par la cession volontaire que lui en avoit faite Artus Gouffier, duc de Roannez, son frère. Le Roi approuva cette cession par lettres du mois d’août 1666. Cf. I, p. 243. Charles-Paris d’Orléans, duc de Longueville, second fils d’Henri II d’Orléans-Longueville et d’Anne-Geneviève de Bourbon, sœur du grand Condé ; son frère aîné s’étant fait prêtre, Charles-Paris avoit hérité du nom et des biens immenses de son frère. Henri de Saint-Nectaire ou Senneterre, duc, pair et maréchal de France, veuf en 1654 de Charlotte de Bauves, épousa en secondes noces (25 avril 1655) Madelaine d’Angennes de La Loupe, née en 1629 et plus jeune que lui de vingt-neuf ans, qui rendit son nom célèbre. Sœur de la comtesse d’Olonne (voy. I, p. 5), elle se distingua par les mêmes scandales. Elle aura son histoire. C’est quarante-trois ans qu’il faudroit dire. Le duc de Longueville, né le 29 juillet 1649, avoit alors près de vingt-trois ans. « Il avoit, dit mademoiselle de Montpensier, le visage assez beau, une belle tête, de beaux cheveux, une vilaine taille. Les gens qui le connoissoient particulièrement disent qu’il avoit beaucoup d’esprit ; il parloit peu ; il avoit l’air de mépriser, ce qui ne le faisoit pas aimer. » (Mém. de Montp., VI, 359.) Le fait dont il est ici parlé sommairement est rapporté tout au long dans le pamphlet des Vieilles amoureuses, qu’on lira dans ce recueil. Le comte de Saulx, plus tard duc de Lesdiguières, étoit fils de François de Lesdiguières, fils lui-même du maréchal de Créqui et de Madelaine de Bonne. Le comte de Saulx épousa Paule-Marguerite-Françoise de Gondi de Retz, nièce de Paul de Gondy, second cardinal de Retz. Madame de Cœuvres étoit Magdeleine de Lyonne ; elle avoit épousé, le 10 février 1670, François-Annibal d’Estrées, troisième du nom, petit-fils du maréchal. Antoine Ruzé, marquis d’Effiat, né en 1638, mort en 1719, étoit fils de Martin Ruzé, dont le frère aîné fut célèbre sous le nom de Cinq-Mars. Sa mère étoit Isabelle d’Escoubleau de Sourdis. L’origine de cette maison ne remonte qu’au milieu du XVIe siècle ; et le marquis d’Effiat, petit-fils du maréchal, n’étoit que le sixième dans les listes généalogiques de la famille, qui, du reste, alliée aux Sourdis, comme nous avons vu, l’étoit aussi aux Montluc. Tout le passage qui suit, entre crochets, manque à l’édition de 1754 ; mais il se trouve dans les éditions antérieures, 1709, 1740, etc. Cet enfant, nommé Charles-Louis d’Orléans, chevalier de Longueville, fut tué au siége de Philisbourg en novembre 1688. Le second enfant de madame de Montespan et de Louis XIV fut Louis-César, comte de Vexin, abbé de Saint-Denis, né en 1672, mort le 10 janvier 1683. Elle eut ensuite : 3º Louise-Françoise, née en 1673 ; 4º Louise-Marie-Anne, etc. Nous parlerons plus loin de madame de Maintenon, dans les notes de l’historiette qui lui est consacrée. Il fut tué le 12 juin 1672, près du fort de Tolhuis, et par sa faute, au moment où il alloit être nommé roi de Pologne. Madame de Sévigné (Lettre du 20 juin 1672) le dit expressément, d’accord avec toutes les relations. Là aussi moururent le comte de Nogent, beau-frère de Lauzun, le marquis de Guitry et un grand nombre d’autres gentilshommes. Mademoiselle de Montpensier dit « qu’il étoit fort aimé des dames. Madame de Thianges étoit fort de ses amies, la maréchale d’Uxelles et beaucoup d’autres. Elles vouloient aller en Pologne avec lui. Quand il mourut, elles en portèrent le deuil et témoignèrent une grande douleur. » (Mém., VI, 359.) Femme de M. de Bertillac, qui servoit alors à l’armée de Hollande. La Gazette parle de lui deux ou trois fois dans des circonstances insignifiantes. Le secret fut assez exactement gardé, à en croire mademoiselle de Montpensier : « La mère du chevalier de Longueville étoit une femme de qualité dont le mari étoit vivant. Il disoit à tout le monde, en ce temps-là : Ne savez-vous point qui est la mère du chevalier de Longueville ? Personne ne lui répondoit, quoique tout le monde le sût. » (Mém., t. 6, p. 361.) M. de Bertillac le père exerçoit seul, depuis 1669, sous le titre de garde du trésor royal, les charges de trésorier de l’épargne, que possédoient avant lui Nicolas Jeannin de Castille, M. de Guénégaud, frère du secrétaire d’État, et M. de La Bazinière. Lui-même avoit exercé une de ces trois charges, avec M. de Tubeuf et M. de Lyonne, et on trouve dans les œuvres de Scarron une épître collective qu’il leur adresse pour se faire payer de sa pension. Nous aurons à reparler de madame de Bertillac. Anne-Louise Habert de Montmort, fille de l’académicien de ce nom, mariée en 1666 avec M. de Bertillac fils. Ce Basque sauteur n’est-il point le Cobus de La Bruyère, comme son Roscius est Baron ? (Voy. l’édit. de La Bruyère donnée dans cette collection, t. 1, 203.) Voy. le 1er vol. de l’Histoire amoureuse, p. 5. Le cabaret de La Durier y étoit fameux, et c’étoit le lieu ordinaire des cadeaux. Madame de Sévigné met cette anecdote sur le compte du duc de Caderousse (voy. la note suivante), et Bussy confirme cette imputation (Lettre du 17 fév. 1680 à M. de la Rivière) : « Caderousse étant allé, le soir même, dans la maison où il avoit perdu la veille, dit avec un air dédaigneux qu’on dit qu’il a, à quelqu’un qui lui demandoit ce qu’il venoit faire là, n’ayant pas un quart d’écu, que les gens comme lui ne manquoient jamais de ressources, et que la bonne femme… n’avoit plus ni bagues ni joyaux. À la vérité il ne voyoit pas que madame de… étoit dans l’alcôve de la chambre avec la maîtresse du logis. Vous pouvez vous imaginer ce que peut penser une femme passionnée qui se voit traiter de la sorte. Elle tomba en défaillance, et, comme elle fut revenue, on la porta dans son carrosse et de là dans son lit, où elle est est morte quatre jours après. » Seulement, disons que Bussy ne nomme pas madame de Bertillac, mais madame de Rambures, belle-mère de Caderousse. Voy. Lettres de Sévigné, édit. Monmerqué. — Cf. ci-dessous, p. 419. Toute cette intrigue dura assez longtemps, puisque madame de Bertillac ne mourut qu’en 1680. Madame de Sévigné raconte sa maladie (Lettre du 24 janv. 1680) et sa mort (7 fév.), et elle confirme la vérité du récit qu’on vient de lire.
« Voici, dit-elle, une histoire bien tragique. Cette pauvre Bertillac est devenue passionnée, pour ses péchés passés, de l’insensible C…; il l’a vue s’enflammer et non pas se défendre ; il a été d’abord au fait et lui a fait mettre en gage ses perles pour soutenir un peu la bassette. On le vit arriver chez madame de Quintin avec mille louis qu’il fit sonner ; sa reconnoissance l’obligea de dire d’où ils venoient. Ce procédé a si excessivement saisi la B… qu’elle en est devenue une image de Benoît, comme autrefois ; et le sang et les esprits ne courant plus, elle est actuellement enflée et gangrenée, de sorte qu’elle est à l’agonie. Nous y passâmes hier, le petit Coulanges et moi. On attend qu’elle expire ; elle est mal pleurée ; le père et le mari voudroient qu’elle fût déjà sous terre. Il n’y a point deux opinions sur cette belle cause de mort. » Cf. p. 417.
Et ailleurs : « Nous fûmes, tout ce que vous connoissez de femmes, au service de cette pauvre B… Il est très vrai que c’est C… qui l’a tuée. »
À peine deux ans après, car le maréchal de La Ferté mourut le 27 septembre 1681. Philippe-Armand du Liscouet, chevalier, vicomte des Planches, étoit fille de Guill. du Liscouet et de Marie de Talhouet. Sa sœur épousa le fameux financier Deschiens. L’abbé de Lignerac, de la famille des Robert, seigneurs de Lignerac et de Saint-Chamans, qui avoient des alliances dans les maisons de Levis, branche de Charlus, et de Hautefort. Fils d’un opérateur. (Note du texte.) Ici finit ce pamphlet dans l’édition de 1754. La suite que nous en donnons est tirée de l’édition de 1709, reproduite dans l’édition de 1740. L’édition de 1754 a intercalé à tort ce passage, partie dans l’histoire de Mademoiselle de Fontanges, partie dans la France devenue italienne, et l’édition Delahays est tombée dans la même faute. Mais si les premières édition de la France galante contiennent ces pages, on ne les trouve pas dans les premiers textes de la France devenue italienne. La duchesse de La Ferté étoit cette même mademoiselle de La Mothe-Houdancourt dont nous avons parlé ci-dessus, p. 49, note 5. Elle épousa, le 18 mars 1675, Henri-François de Saint-Nectaire, duc de La Ferté, fils du maréchal. Louis, dauphin, fils de Louis XIV et de Marie-Thérèse, né le 1er novembre 1661, mort le 14 avril 1711 ; Montausier fut son gouverneur, Bossuet son précepteur. Voy. p. 49. Madame de La Mothe, connue avant son mariage sous le nom de mademoiselle de Toussy, et fort célèbre dans les poètes du temps, Bois-Robert et autres, étoit fille de Louis de Prie, marquis de Toussy, et de mademoiselle de Saint-Gelais-Lusignan. Née en 1624, elle mourut le 6 janvier 1709. Elle fut gouvernante du Dauphin jusqu’en 1668, où il quitta les mains des femmes ; mais elle conserva le titre de gouvernante des enfants de France, avec 3,600 livres de gages. Mariée le 21 novembre 1650, elle étoit veuve depuis le 24 mars 1657. Charlotte-Éléonore-Magdeleine, mariée le 14 mars 1671. Louis-Charles de Levis, duc de Ventadour, étoit fils de Charles de Levis, duc de Ventadour, et de sa seconde femme, Marie de La Guiche, fille du maréchal de ce nom. Il mourut en 1717. Henri-François de Saint-Nectaire, fils de la trop fameuse maréchale de La Ferté, né le 23 janvier 1657, suivit, à peine âgé de quinze ans, le roi à la conquête de Hollande. À dix-sept ans, il succédoit à son père dans le gouvernement de Metz et du pays messin. Il prit part à quelques campagnes avec le titre de lieutenant général, et mourut le 1er août 1703. Cabaret célèbre dans la rue nommée successivement rue aux Oues (aux Oies) et rue aux Ours. Gaston Jean-Baptiste-Antoine de Roquelaure, fils de Gaston, duc de Roquelaure, et de mademoiselle du Lude (Charlotte-Marie de Daillon). Il porta le nom de marquis de Biran jusqu’à la mort de son père, arrivée en mars 1683 ; gouverneur de Lectoure, lieutenant général des armées, commandant en chef en Languedoc, il fut nommé maréchal de France le 2 février 1724. Antoine-Martin, bailli et grand-croix de Malte, général des galères de cet ordre, colonel du régiment de Champagne après avoir été capitaine-lieutenant des mousquetaires du Roi, étoit le troisième fils de Jean-Baptiste Colbert et de Marie Charron. Blessé à Valcourt le 25 août 1689, il mourut de sa blessure le 2 septembre suivant. Marie-Louise de Laval, fille d’Urbain de Laval, marquis de Lezay, et de Françoise de Sesmaisons, épousa le marquis de Biran le 20 mai 1683. Il sera reparlé d’elle et de la courte intrigue qui lui valut la faveur du Roi. Sensible. Nous n’avons plus ce mot que dans le sens de « digne de pitié. » Sortir pour tirer n’étoit pas plus françois alors que maintenant. M. L’Avocat, maître des requêtes, étoit fils de Nicolas L’Avocat de Sauveterre, maître des comptes, et de Marguerite Rouillé, et beau-frère d’Arnauld de Pomponne. — Saint-Simon en parle ainsi (II, p. 411, édit. Sautelet) : « Un bonhomme, mais fort ridicule, mourut en même temps (1700), ce fut un M. L’Avocat, maître des requêtes, frère de madame de Pomponne et de madame de Vins, qui avoit des bénéfices et beaucoup de biens, qui alloit partout, qui avoit eu toute sa vie la folie du beau monde, et de ne rien faire qu’être amoureux des plus belles et des plus hautes huppées, qui rioient de ses soupirs et lui faisoient des tours horribles. C’étoit, avec cela, un grand homme maigre, jaune comme un coing et qui l’avoit été toute sa vie, et qui, tout vieux qu’il étoit, vouloit encore être galant. » Louison d’Arquien, célèbre courtisane. Tout le monde connoît, par les lettres de madame de Sévigné et par Tallemant, l’histoire du congrès du marquis de Langey ou Langeais. René de Cordouan tenoit par son père à une famille qui avoit eu de glorieuses alliances, et, du côté maternel, il comptoit parmi ses ancêtres les du Bellay, les Beaumanoir-Lavardin et François de la Noue Bras-de-fer, maréchal de France. Né le 27 janvier 1628, le marquis de Langey épousa, en 1653, Marie de Saint-Simon, marquise de Courtaumer, née vers 1639 ; en 1657, le congrès eut lieu, au grand scandale de Paris tout entier, et en 1659 le mariage fut dissous : chacun des deux époux eut le droit de se remarier, et le marquis ayant épousé, en 1661, mademoiselle de Navailles, fille du duc de ce nom, eut d’elle jusqu’à sept enfants, malgré son impuissance judiciairement constatée. Aucun ouvrage ne donne plus de détails sur ce procès singulier et sur le marquis de Langeais que les Mémoires de Jean Rou, récemment publiés par la Société de l’histoire du protestantisme françois, 2 vol. in-8, 1857. Simon Arnauld, marquis de Pomponne, fils de Robert Arnauld d’Andilli, épousa, en 1660, Catherine L’Advocat. En 1671 il revint de Suède, où il avoit été envoyé comme ambassadeur, pour occuper la place de ministre d’État pour les affaires étrangères. M. de Tilladet étoit fils de Gabriel de Cassagnet, marquis de Tilladet, capitaine au régiment des gardes, et de Magdelaine Le Tellier, sœur du chancelier, tante du marquis de Louvois. Françoise-Angélique de La Mothe-Houdancourt, mariée le 26 novembre 1669 à Louis-Marie d’Aumont et de Roche-Baron, duc d’Aumont, premier gentilhomme de la chambre du roi, dont elle fut la seconde femme. Louis-Marie-Victor d’Aumont, fils d’Antoine, duc d’Aumont, maréchal de France, et de Catherine Scarron de Vaures, né en 1632, mort en 1704. Après la mort de son père, 14 février 1669, il prit son titre de duc et pair, résigna sa charge de capitaine des gardes du corps, et prêta, à la date du 11 mars 1669, serment de fidélité pour la charge de premier gentilhomme de la chambre. Il avoit épousé, le 21 novembre 1660, Madeleine Fare Le Tellier, fille du chancelier de France, sœur du marquis de Louvois, qui mourut le 22 juin 1668. Anne de Levis, duc de Ventadour, grand-père du duc dont il est ici parlé, avoit épousé, le 26 juin 1593, Marguerite de Montmorency, sa cousine, qui mourut le 3 décembre 1660. Celle-ci étoit fille de Henri de Montmorency, dont une autre fille, née d’un second lit, épousa Henri de Bourbon, père du grand Condé. Il y avoit au faubourg Saint-Marceau, rue de Lourcine, un couvent de religieuses cordelières de l’ordre de Sainte-Claire. L’abbesse y étoit élective et triennale, et y jouissoit de dix mille livres de rentes. Les maréchaux de France formoient un tribunal d’honneur qui jugeoit toutes les contestations personnelles soulevées entre gentilshommes. Ils avoient des lieutenants dans différentes villes du royaume. Il existe des recueils d’édits concernant cette juridiction, établie pour accommoder les différends et empêcher les duels le plus possible. « On dit qu’un homme ne fait point d’ordinaire quand il n’a point de pot-au-feu, quand il envoie quérir un ordinaire à la gargotte, ou quand il est écorniffleur, quand il va quêter ça et là des repas. » (Furetière.) Marie-Louise de Laval, mariée l’an 1683 au marquis de Biran, depuis duc et maréchal de Roquelaure. Voy. ci-dessus, p. 426. Marie-Charlotte de Roquelaure, fille du duc Gaston et de Charlotte-Marie de Daillon du Lude, avoit épousé, le 8 mars 1674, Henri-François de Foix de Candale, duc de Foix. Née en 1655, elle mourut le 22 janvier 1710. La foire Saint-Germain avoit le privilége d’attirer toute la cour ; aussi s’y passoit-il souvent des aventures singulières. Loret (Muze historique) en rapporte quelques-unes. On a de Colletet un long poème où il en décrit les merveilles. Locution alors nouvelle, empruntée à la langue des précieuses. Voy. p. 420. Tout le passage qui suit, et que nous laissons ici, comme toutes les premières éditions de ce pamphlet, a été ensuite reporté, à tort, dans l’histoire de mademoiselle de Fontanges, qu’on lira plus loin. Il finit page 464. Le prince de Marsillac étoit François de La Rochefoucauld, fils de l’auteur des Maximes et de Andrée de Vivonne. Le prince de Marsillac, né le 15 juin 1634, mourut le 12 janvier 1714. Voy. plus haut, p. 412. Gui de Chaumont, marquis de Guitri, étoit grand maître de la garde-robe en même temps que le marquis de Soyecourt. Marie-Angélique de Scorraille, demoiselle de Fontanges, étoit la sixième des sept enfants de Jean Rigaud de Scorraille, comte de Roussille, et d’Aimée-Éléonore de Plas ; la mère de mademoiselle de Fontanges étoit petite-fille par sa mère du maréchal de La Châtre. Née en 1661, on sait qu’elle mourut à l’âge de vingt ans, le 28 juin 1681. Les filles d’honneur de la reine avoient deux cents livres de gages : celles de Madame ne pouvoient être rétribuées beaucoup plus largement, quoique chez Monsieur et chez Madame plusieurs charges fussent plus avantageuses que chez le Roi. Ici finit le passage intercalé par certaines éditions dans l’histoire de mademoiselle de Fontanges. Voy. p. 454. La charge de grand veneur a toujours été exercée par les gentilhommes des plus qualifiés de la cour ; nous y voyons, avant le prince de Marsillac, le duc de Rohan et le marquis de Soyecourt. Le passage qui suit, entre crochets, a été intercalé aussi dans l’histoire de mademoiselle de Fontanges, à la fin. Mais nous suivons les premières éditions. Madame de Sévigné, lettre du 6 avril 1680 : « Madame de Fontanges est duchesse, avec vingt mille escus de pension ; elle en recevoit aujourd’hui les compliments dans son lit. Le Roi y a été publiquement ; elle prend demain son tabouret et s’en va passer le temps de Pâques à une abbaye que le Roi a donnée à une de ses sœurs. Voici une manière de séparation qui fera bien de l’honneur à la sévérité du confesseur. Il y a des gens qui disent que cet établissement sent le congé. En vérité, je n’en crois rien ; le temps nous l’apprendra. Voici ce qui est présent : Madame de Montespan est enragée ; elle pleura tout hier. Vous pouvez juger du martyre que souffre son orgueil, qui est encore plus outragé par la haute faveur de madame de Maintenon. » Madame de Sévigné parle de cette prodigalité de madame de Fontanges : « Je vous ai parlé de toutes les beautés, de toutes les étrennes ; Fontanges en a donné pour vingt mille écus, sans que la pensée lui soit venue de faire un présent à madame de Coulanges. » (12 janv. 1680.) Dans une autre lettre, où elle parle du voyage que fit mademoiselle de Fontanges avec le Roi, qui alloit au-devant de madame la Dauphine, on lit : « On mande qu’on s’est fort diverti à Villers-Cottrets ; je ne vois pas que les visites à ce carrosse gris (où étoit la favorite) aient été publiques. La passion n’en est pas moins grande. On (c’est-à-dire elle) reçut en montant dans ce carrosse dix mille louis et un service de campagne de vermeil doré. La libéralité est excessive, et on répand comme on reçoit. » (1er mars 1680.) Anne-Jules de Noailles, fils d’Anne de Noailles et de Louise Boyer, né le 5 février 1650. Après s’être fait remarquer dans plusieurs campagnes, il suivit le Roi à la conquête, de la Franche-Comté en 1674. En 1677, par la démission de son père, il fut fait duc de Noailles et pair de France ; en 1678, il obtint le gouvernement de Roussillon qu’avoit eu son père. Sa faveur étoit donc antérieure à l’emploi qu’il avoit accepté. Marié depuis le 13 août 1671 avec Marie-Françoise de Bournonville, il eut de ce mariage vingt et un enfants. Le passage qui suit, entre crochets, a été intercalé encore dans les dernières éditions de l’histoire de mademoiselle de Fontanges, mais au début. Madame de Sévigné parle en effet d’une perte de sang continuelle qui avoit ruiné la santé de mademoiselle de Fontanges. Dans sa lettre du 1er mai 1680 elle dit même : « Vous savez tout ce que la fortune a soufflé sur la duchesse de Fontanges. Voici ce qu’elle lui garde : une perte de sang si considérable qu’elle est encore à Maubuisson, dans son lit, avec une fièvre qui s’y est mêlée. Elle commence même à enfler ; son beau visage est un peu bouffi. » Cependant mademoiselle de Fontanges revint à la cour et retrouva une apparence de faveur. Mais le Roi ne quittoit pas madame de Maintenon, et mademoiselle de Fontanges, au dire de madame de Sévigné, ne cessoit de pleurer son bonheur perdu. Enfin la lettre du 1er septembre 1680 constate les soupçons d’empoisonnement : « On dit que la belle beauté a pensé être empoisonnée… Elle est toujours languissante. » Encore un passage intercalé dans l’histoire de mademoiselle de Fontanges, dans les mauvaises éditions. À l’abbaye de Port-Royal de Paris, où elle mourut. Louis Léger de Scorrailles, abbé de Valloire, mort en 1692. Catherine Gasparde, mariée à Sébastien de Rosmadec, lieutenant général de Bretagne, gouverneur de Nantes, brigadier et mestre de camp de cavalerie. Par exemple, il donna l’abbaye de Chelles à Jeanne de Scorrailles, qui étoit religieuse à Faremoustier, et qui fut bénite abbesse le 25 août 1680. Madame de Sévigné parle du voyage que fit à Chelles madame de Fontanges, pour assister à la cérémonie d’installation de sa sœur : « Madame de Fontanges est partie pour Chelles ; assurément je l’irois voir si j’étois à Livry. Elle avoit quatre carrosses à six chevaux, le sien à huit. Toutes ses sœurs étoient avec elle, mais tout cela si triste qu’on en avoit pitié : la belle perdant tout son sang, pâle, changée, accablée de tristesse, méprisant quarante mille écus de rente et un tabouret qu’elle a, et voulant la santé et le cœur du Roi qu’elle n’a pas. » (Lettre du 17 juillet 1680.) Le passage qui suit, entre crochets, a été encore introduit textuellement dans l’histoire de mademoiselle de Fontanges. On y retrouve aussi les lignes qui précédent, mais légèrement modifiées. Madame de Maintenon aura plus tard son historiette. C’est le pamphlet connu sous le titre de : les Vieilles amoureuses. Madame de Lionne. C’est par ces mots que finit, dans les éditions de pacotille, l’histoire de mademoiselle de Fontanges. Le passage qui suit, jusqu’à la fin, manque dans les éditions qui ont pillé cette histoire au profit de celle de mademoiselle de Fontanges. Mademoiselle de Montpensier se plaint souvent de Lauzun, qui, à son retour de Pignerolles, affecte de faire l’empressé auprès des dames et se montre d’une avidité insatiable. Voy. surtout t. 7, p. 53 et suiv., édit. citée. « Le roi permit que je donnasse du bien à M. de Lauzun. D’abord il fut dit de lui donner Châtellerault et quelques autres de mes terres du voisinage. Il n’en voulut pas ; il aima mieux le duché de Saint-Fargeau, qui étoit alors affermé 22,000 livres, la ville et baronnie de Thiers, en Auvergne, qui est une des plus belles terres de la province, de la valeur de 8,000 livres, et 10,000 livres de rente par an sur les gabelles du Languedoc. Au lieu d’être content, il se plaignit que je lui avois donné si peu qu’il avoit eu peine à l’accepter. » Cette maison, que mademoiselle de Montpensier acheta du président Gontier, quand ses créanciers le forcèrent de la vendre, fut en effet longtemps en construction. Mais le luxe qu’y déploya Mademoiselle ne pouvoit s’improviser, et, par la description qu’elle en fait (t. 7, p. 31 et suiv.), on comprend qu’elle ait été plusieurs années avant de la voir terminée.
See also

